Amadou BARRY est avocat aux Barreaux de Guinée et du Québec. Diplômé d’un Bachelor of Laws (LL.B.) de l’Université de Montréal et d’un Master 2 en droit des contrats et garanties du crédit de l’Université Paris-Est Créteil, il a effectué son parcours académique en France puis au Canada. Après près de dix ans d’expériences au sein de cabinets d’avocats de premier plan en France et au Canada, c’est en 2020 que Me BARRY décide de rentrer en Guinée, ayant à cœur de contribuer activement à cette transformation et mettre à profit l’expérience acquise au sein de grands cabinets internationaux pour conseiller sur le terrain les acteurs africains et internationaux. En 2024, il fonde Icarus Legal, cabinet d’avocats indépendant spécialisé en droit des affaires, financement de projets et structuration d’investissements. Le Cabinet conseille une clientèle composée de sociétés guinéennes et internationales, acteurs publiques et institutions financières dans la structuration de leurs transactions notamment dans les secteurs miniers, énergétiques et des infrastructures. Il intervient également en matière contentieuse. Icarus Legal se distingue par son positionnement à l’intersection des systèmes OHADA et de Common Law. Il se définit comme Trusted Advisor impliqué sur le long terme et qui comprend les enjeux stratégiques, opérationnels et culturels de ses clients. Depuis son lancement, le cabinet a conseillé un acteur majeur du secteur de l’or dans l’acquisition d’une société minière internationale qui exploite un projet aurifère en République de Guinée. Il assiste également l’État guinéen sur plusieurs projets énergétiques ainsi que le consortium mis en place pour le développement des infrastructures du vaste projet du minerai de fer de Simandou, le plus grand projet minier au monde valorisé à près de 20Md de Dollars. INTERVIEW
Selon vous, qu’est-ce que le financement de projets d’infrastructures a-t-il de spécifique juridiquement ?
Contrairement à un financement classique, le financement de projet d’infrastructures repose sur des montages complexes où les flux financiers, les risques et les responsabilités sont soigneusement répartis entre sponsors, prêteurs et pouvoirs publics. La spécificité principale est donc de parvenir à un équilibre contractuel entre des parties prenantes aux intérêts parfois divergents. Cela implique notamment des montages contractuels complexes et souvent transfrontaliers. Ces montages contractuels devront par conséquent tenir compte des considérations de droit étranger distinct de nos régulations internes et OHADA.
Pouvez-vous, nous éclairer sur les principaux enjeux juridiques liés au financement de projets d’infrastructures ?
Le financement des projets d’infrastructures met en lumière un défi constant : trouver un équilibre entre la préservation des intérêts de multiples acteurs publics et privés et la sécurisation juridique d’un cadre contractuel complexe. En termes simples, il s’agit de garantir que les intérêts des différents intervenants (sponsors, prêteurs, pouvoirs publics, etc) soient protégés tout en assurant la viabilité à long terme du projet à travers les divers accords contractuels. Du côté des sponsors, un enjeu clé est par exemple la durée d’exploitation consacrée dans le contrat de concession, ainsi que la garantie des droits de propriété et d’exploitation des actifs, avec notamment des protections contre l’expropriation. Un autre enjeu réside dans la mise en place des sûretés ou « security package » qui garantissent la solidité de l’opération. . Leur structuration soulève souvent des défis par exemple en présence de pratiques issues du Common Law et d’exigences du droit OHADA, en particulier l’Acte uniforme sur les sûretés. Les prêteurs internationaux attendent généralement des standards proches du Common Law alors même que le droit OHADA impose ses propres conditions. Trouver cet équilibre est un exercice délicat mais essentiel. Enfin, ce financement implique une relation particulière entre le sponsor et l’État, ce dernier agissant à la fois comme autorité publique et partenaire contractuel. Il faut donc pour chaque projet trouver le juste équilibre entre le rôle régalien de l’État et les garanties attendues par les investisseurs : clauses de stabilisation ou encore recours à l’arbitrage international en cas de litige. Ces mécanismes sont fondamentaux pour sécuriser les transactions et attirer les investisseurs.
Entre les différents types de montage juridique de projets d’infrastructures, les PPP semblent être plébiscités. Pourquoi ? Quelle est sa valeur ajoutée ?
Les projets d’infrastructures sont, par nature, très intensifs en capital (Capital Intensive). Le financement de ce type de projet peut rapidement peser lourdement sur les finances publiques, surtout dans les économies en développement. C’est dans ce contexte que les Partenariats Public-Privé (PPP) sont apparus comme un outil stratégique permettant de répondre aux besoins en infrastructures sans recourir à un endettement direct de l’État. Concrètement, un PPP bien structuré permet à l’État de s’appuyer sur l’expertise technique et la capacité de mobilisation financière du secteur privé. Les sponsors de ces projets disposent souvent de l’expérience nécessaire pour structurer, financer et exécuter des projets complexes qu’il s’agisse d’un barrage hydroélectrique, d’un aéroport ou d’une autoroute. Cela permet de gagner du temps, d’améliorer la qualité d’exécution tout en limitant l’exposition budgétaire de l’État. Sur le plan juridique et financier, le financement des PPP présente parfois l’avantage d’utiliser une approche appelée limited recourse qui contribue à réduire les risques de recours et saisies contre les actifs publics. Enfin, il faut replacer cette dynamique dans le contexte africain actuel : forte croissance démographique, urbanisation rapide, attentes sociales croissantes… Face à ces défis, les États doivent aller vite et mobiliser des ressources importantes. Les PPP offrent un moyen d’agir efficacement, tout en gardant une relative marge de manœuvre budgétaire. C’est cette combinaison de facteurs qui explique l’attrait croissant pour ce type de montage.
Ses détracteurs estiment que le PPP « dessaisit » l’administration de ses compétences et constituerait, de ce fait une « privatisation » déguisée. Êtes-vous de cet avis ?
Je n’irai pas aussi loin dans le constat. Il me semble d’ailleurs nécessaire de tempérer ce type de propos. Il est vrai que, dans les faits, un PPP peut conduire à des situations où des acteurs privés se retrouvent à exploiter ou fournir un service relevant normalement de la compétence de la puissance publique. Toutefois, ce genre de configuration ne peut être assimilé à une privatisation au sens juridique du terme. Les PPP reposent sur un encadrement contractuel clair entre une autorité publique et un investisseur privé. Les droits d’exploitation et les garanties consentis au partenaire privé sont le fruit de négociations. Ces négociations permettent à l’État de défendre certains principes fondamentaux. Il est courant que l’investisseur accepte de faire des compromis et de répondre aux attentes légitimes de la partie publique. A titre d’exemple, de nombreux États africains ont récemment adopté des lois sur le contenu local afin de garantir une certaine inclusivité dans les projets structurants. Dans ce cadre, les conventions de concession par exemple consacrent des engagements fermes en matière d’emploi local ou de recours à des sous-traitants nationaux. De la même manière, les critères de fixation des coûts à la charge des usagers ou encore les exigences environnementales, y compris les plans de gestion environnementale sont généralement imposés par les pouvoirs publics dans le cadre des PPP. Précisons enfin que les PPP restent généralement des contrats à durée déterminée avec une période d’exploitation encadrée et limitée dans le temps.
La mise en œuvre d’un PPP exige de la part de la personne publique des compétences de haut niveau tant au stade de la passation du contrat (structuration en mode « projet ») que pour son suivi. En Afrique et plus particulièrement en Guinée, ces ressources humaines sont-elles disponibles ?
La mise en œuvre efficace d’un PPP repose largement sur la disponibilité de compétences humaines qualifiées et ce, à plusieurs étapes clés. Cela concerne aussi bien la phase de structuration du projet qui exige une approche en mode « projet » que celle du suivi et du contrôle. Au-delà des questions de financement, la complexité des PPP impose aux entités publiques des compétences techniques pointues, notamment en analyse juridique, financière et technique. En Guinée, comme dans de nombreux pays africains, la question des ressources humaines spécialisées dans ce domaine est un défi constant. Durant la passation et la structuration des projets, les autorités publiques ont souvent recours à des experts externes — juridiques, techniques, financiers — pour combler ce manque. Ces conseils apportent un appui essentiel pour garantir la qualité et la viabilité des projets. Cependant, pour assurer un suivi opérationnel efficace, la présence de compétences internes pérennes est indispensable. C’est pourquoi la Guinée s’efforce de renforcer ces capacités, notamment via des partenariats avec des institutions multilatérales. Des acteurs comme la Banque mondiale, à travers sa World Bank Group Academy et son programme « Strengthening Client Capacity for Impact », jouent un rôle important dans ce processus. Au niveau continental, l’African Legal Support Facility offre également un appui juridique spécialisé et des formations ciblées, particulièrement dans des secteurs complexes tels que l’énergie et les ressources extractives. Par ailleurs, certaines administrations guinéennes font appel à des Project Management Officer (PMO) externes, qui sont intégrés sur le long terme et apportent un soutien technique quotidien dans la mise en œuvre, le suivi et l’adaptation des projets.
Quid de la régulation juridique des PPP ? Le Droit OHADA la prévoit-il ?
A ce jour, la règlementation OHADA ne prévoit pas de régime juridique harmonisé dédié aux PPP. Chaque État membre conserve sa liberté de légiférer en la matière. C’est pourquoi on observe à l’échelle régionale une multiplication des cadres juridiques nationaux encadrant les PPP. Par exemple, la République de Guinée s’est dotée d’une législation spécifique avec la Loi n°0032/2017/AN du 4 juillet 2017, tandis que le Sénégal a adopté la Loi n°2021‐01 du 22 février 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé. D’autres États comme le Bénin, le Togo ou le Mali ont également mis en place des textes récents dans le même sens. Cela reflète une volonté partagée de sécuriser les investissements dans les infrastructures tout en gardant la maîtrise de l’outil législatif.
Concrètement, comment les investisseurs peuvent-ils sécuriser juridiquement un PPP contre les risques politiques ou sécuritaires ?
La protection des investissements contre les risques politiques et sécuritaires est un enjeu majeur dans la structuration des projets PPP. Forts des expériences passées, les investisseurs demandent systématiquement l’intégration de dispositifs spécifiques visant à limiter ces risques. Dans les contrats conclus entre autorités publiques et investisseurs, plusieurs clauses sont négociées pour encadrer ces risques. La clause de stabilisation qu’elle soit juridique ou fiscale est l’une des plus courantes. Elle permet de maintenir et figer dans le temps le cadre légal ou fiscal applicable au projet même en cas d’évolutions politiques susceptibles d’entraîner des réformes juridiques importantes. Par ailleurs, les clauses d’arbitrage offrent aux investisseurs la possibilité de porter un éventuel litige devant un organisme extérieur, excluant ainsi la crainte d’une éventuelle impartialité en cas de litige. Au-delà des garanties contractuelles, des institutions multilatérales proposent également des mécanismes d’assurance et de garantie pour couvrir les risques politiques et sécuritaires. La Banque mondiale, via la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), est un acteur important sur ce terrain. De même, la Banque Islamique de Développement, à travers la Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC), propose des couvertures spécifiques pour les investissements transfrontaliers, couvrant tant les risques politiques que commerciaux. Ces dispositifs combinés, contractuels et multilatéraux, renforcent significativement la sécurité juridique des projets PPP et contribuent à leur attractivité pour les investisseurs.
Quelles sont, selon vous, les conditions pour que les PPP soient une option économiquement viable pour la fourniture d’infrastructures publiques ?
Il s’agit d’une combinaison de plusieurs éléments. Un PPP économiquement viable, c’est d’abord un projet bien structuré sur le plan juridique et financier. Les contrats doivent encadrer des aspects essentiels comme l’accès au foncier, la durée d’exploitation, la sécurité des investissements ou encore la réalisation d’études techniques et environnementales en amont. Tout cela se négocie en détail pour garantir un minimum de prévisibilité et de stabilité pour les parties prenantes. Les études financières et techniques prévisionnelles constituent également des facteurs clés pour la viabilité économique d’un PPP. Par exemple dans une infrastructure de transport, les études de trafic joueront un rôle déterminant. Dans nos économies africaines, d’autres facteurs doivent également être pris en considération, je pense notamment à l’acceptabilité sociale et la stabilité institutionnelle. Sur le plan social, il est essentiel que les populations comprennent et acceptent les projets. Cela passe par un vrai dialogue sur les tarifs d’utilisation qui jouent un rôle fondamental dans l’amortissement du financement du projet, mais aussi par des politiques d’inclusion comme le contenu local, qui permet aux citoyens de bénéficier directement du projet, à travers l’emploi ou l’accès aux marchés publics. Côté institutionnel, la stabilité de l’État est une condition de base. Les PPP s’inscrivent généralement sur 20 ou 30 ans de durée. La rentabilité du projet pour un investisseur se fait sur le long terme. Si les règles changent à chaque alternance, ou si l’administration est constamment remaniée, les projets s’en trouvent fragilisés. Il faut donc une vision de long terme, partagée par tous les acteurs de la chaîne publique. Finalement, un PPP ne peut être viable que s’il respecte un équilibre clair entre les intérêts de l’État, des investisseurs, des bailleurs et des citoyens. C’est cet équilibre technique, économique et humain qui garantit la pérennité du modèle.
Quelles sont les modalités de règlement des différends dans les projets d’infrastructures ? Entre le recours à l’arbitrage (institutionnel ou ad hoc) et un mode alternatif de règlement des litiges, lequel est le plus souvent privilégié ? Pourquoi ?
Aujourd’hui, l’arbitrage international s’impose clairement comme le mode de règlement des différends le plus couramment utilisé en cas de litiges. La majorité des contrats prévoit une clause d’arbitrage souvent en faveur d’un arbitrage institutionnel, comme celui du CIRDI ou de la CCI. Ce choix s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, l’arbitrage offre une forme de neutralité que les investisseurs jugent indispensable, surtout lorsqu’ils contractent avec un État. Il garantit aussi une confidentialité des procédures, une exécution internationale des sentences, et un certain formalisme qui rassure les parties. Même si cela représente un coût, c’est une sécurité juridique très recherchée. En République de Guinée, par exemple, la loi PPP de 2017 prévoit explicitement la possibilité pour les parties de recourir à l’arbitrage international. Cela reflète une volonté de créer un environnement contractuel attractif et sécurisé pour les investisseurs.
D’une manière générale, pensez-vous qu’en Afrique et plus particulièrement en Guinée, les législations régissant les PPP et leur financement, sont adaptées ? Donnent-t-elles aux bailleurs de fonds et aux investisseurs potentiels les assurances voulues ?
Les cadres législatifs consacrés aux PPP en Afrique, et plus spécifiquement en Guinée, se caractérisent par leur relative nouveauté. Dans la majorité des cas, ces textes récents sont venus remplacer d’anciens dispositifs juridiques, notamment les lois BOT (Build Operate Transfer), qui servaient de fondement à la réalisation de grands projets d’infrastructure. Les lois relatives aux PPP adoptées ces dernières années visent à offrir un cadre plus exhaustif, équilibré et attractif pour le lancement de nouveaux projets. Elles ont ainsi pour objectif de combler certaines lacunes juridiques et d’apporter des améliorations concrètes dans la structuration des PPP. En pratique, ces nouvelles réglementations introduisent plusieurs innovations et dispositions favorables aux bailleurs de fonds et aux investisseurs. L’exemple de la loi PPP en Guinée, adoptée en 2017, illustre ces avancées : elle a abrogé l’ancienne loi BOT de 1998 et consacre, à titre d’exemple, des droits réels sur les actifs concernés par les projets de PPP. Ces droits réels confèrent aux investisseurs des prérogatives semblables à celles d’un propriétaire temporaire sur les biens, et la loi prévoit que ces droits peuvent faire l’objet de sûretés, ce qui constitue un facteur de réassurance pour les bailleurs. Bien que ces textes soient appelés à évoluer, notamment à l’aune des retours d’expérience issus des premiers projets PPP, il convient de souligner que les législations actuellement en vigueur forment d’ores et déjà un socle juridique attractif et propice à la mise en place de nouveaux PPP.
Propos recueillis par A.C. DIALLO – ©Magazine BUSINESS AFRICA



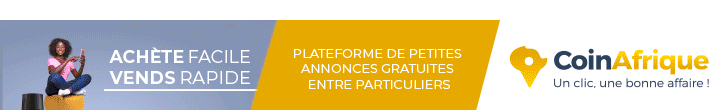

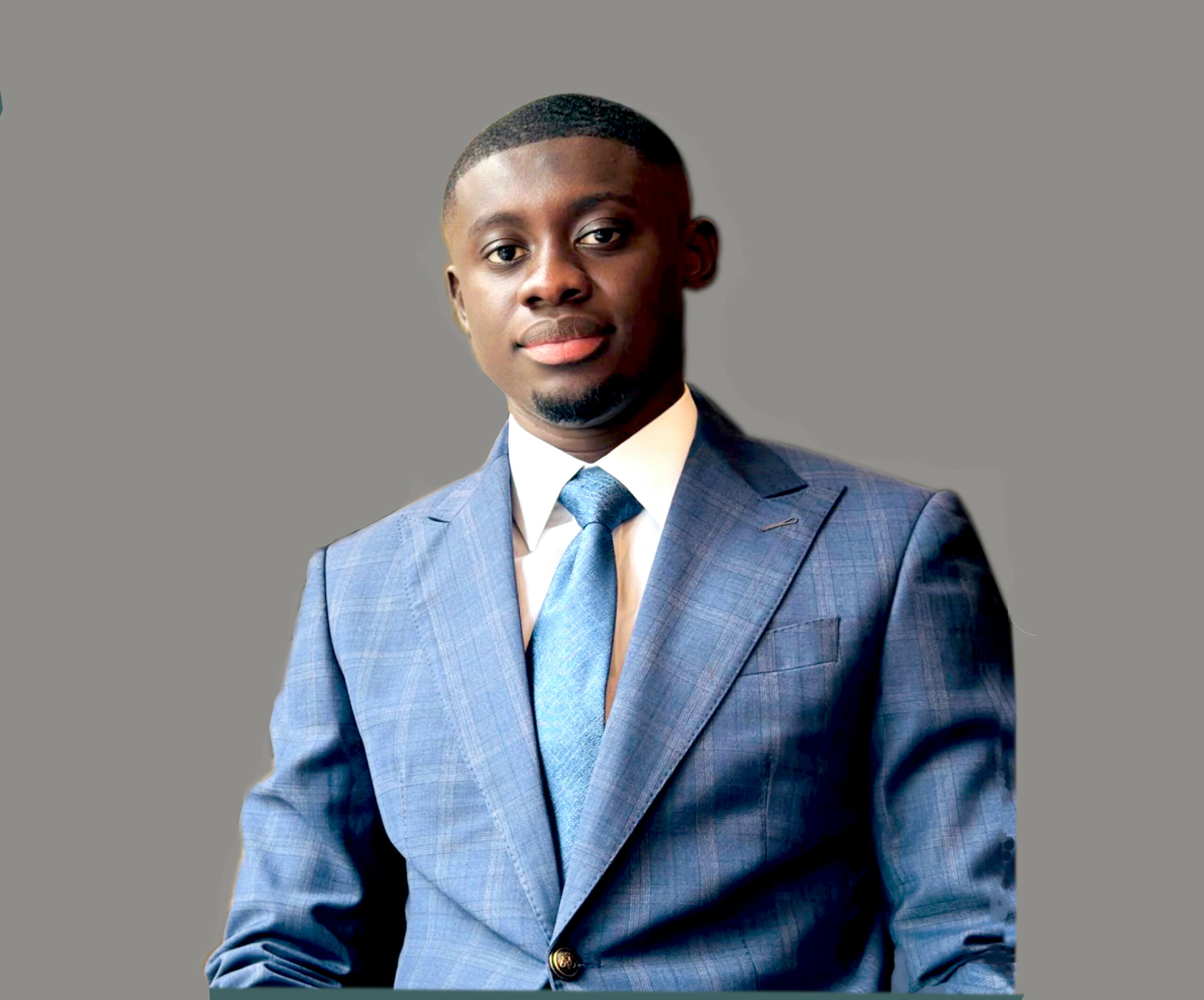








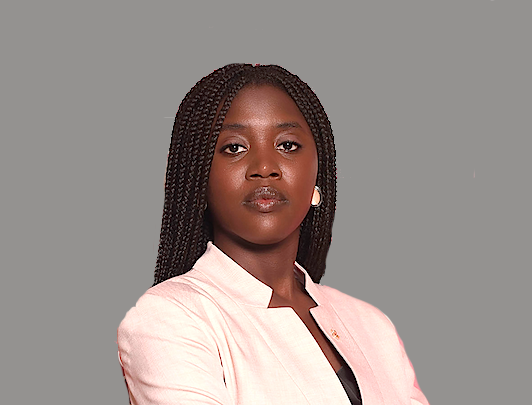


Laisser un commentaire