François de Senneville est Associé et en charge du Groupe Afrique au sein du bureau parisien de Fieldfisher. Reconnu pour son expertise en matière de fiscalité internationale, et de droit des affaires africain (notamment OHADA), il assiste depuis plus de vingt-cinq ans de grands groupes internationaux dans leurs projets de développement, de réorganisation de leurs activités internationales et de structuration de leurs acquisitions.
Pour le Magazine BUSINESS AFRICA, il livre son analyse sur les spécificités juridiques du financement de projets d’infrastructures. INTERVIEW
Tout d’abord, pouvez-vous nous expliquez en quelques mots, comment est structuré le groupe Afrique de Fieldfisher ?
Depuis la création du groupe Afrique de Fieldfisher fin 2015, nous avons souhaité nous structurer avec un avantage compétitif et la particularité de proposer un business model innovant qui repose sur une équipe centrale senior réduite menée par des Africains, je suis moi-même mauricien, pour coordonner nos interventions, pour des projets africains. Ajoutez à cela une équipe d’experts (internes et externes au cabinet) aux compétences variées et nous pouvons donc intervenir sur une très large typologie de dossiers dans tous les secteurs d’activités, y compris pour les Projets Publics-Privés. Nous sommes fiers de notre adaptabilité et de notre capacité à trouver l’équipe sur mesure qui conviendra pour chaque projet, qu’ils fassent parti du Cabinet ou non.
Notre souci est avant tout de réunir les experts qui permettront de servir le client pour chacun des projets qui nous est confié. Notre business model unique a fait la preuve de sa résilience et de sa pertinence pour répondre aux besoins de nos clients. L’Afrique est un continent immense qui présente une forte hétérogénéité et qui recouvre des réalités et des niveaux de développement économique contrastés. C’est pour les aider à faire face à cette complexité que nos clients nous sollicitent.
Nos attaches profondes sur le continent nous permettent de nous appuyer sur un réseau de relations solide et sur une compréhension fine des réalités locales pour mener à bien leurs projets.
Pour chaque dossier, nous mobilisons l’équipe aux compétences les plus adaptées, la force de frappe d’un cabinet international et notre connaissance du terrain, pour les accompagner sur l’ensemble de leur projet.
Quelles sont, selon vous, les spécificités juridiques du financement de projets d’infrastructures ?
Le financement de projets d’infrastructures présente plusieurs spécificités juridiques :
Le financement de projets d’infrastructures nécessite des contrats à long terme. En effet, les projets d’infrastructures nécessitent des engagements contractuels sur des périodes longues, souvent de plusieurs décennies. Cela implique une attention particulière à la définition des droits et obligations des parties, ainsi qu’à la gestion des risques. Par ailleurs, ces contrats rassemblent de multiples acteurs pour des partenariats complexes. Les projets d’infrastructures impliquent généralement plusieurs parties prenantes (État, investisseurs privés, banques, entrepreneurs, etc.), ce qui rend les montages juridiques complexes. Cela nécessite un cadre juridique clair pour coordonner les rôles et responsabilités. D’autre part, le financement des projets d’infrastructures peut inclure diverses sources, tels des fonds publics, des financements privés, des prêts internationaux, ainsi que des garanties. Le cadre juridique doit donc garantir la sécurité des transactions financières et protéger chacune de ces parties prenantes contre les risques financiers. Il s’agit d’une autre source de complexité qu’il convient de gérer. N’oublions pas de citer parmi les autres spécificités à gérer juridiquement les risques politiques et économiques.
En effet, les projets d’infrastructure sont souvent confrontés à des risques liés à la stabilité politique et à l’évolution économique. Il est crucial d’intégrer des mécanismes de gestion des risques dans le montage juridique, tels que des garanties contre les risques politiques.
Pourriez-vous nous indiquer, s’agissant du continent africain, les principaux enjeux juridiques liés au financement de projets d’infrastructures ?
En Afrique, les enjeux juridiques du financement des projets d’infrastructures sont multiples.
Les premiers enjeux à gérer naissent de l’instabilité politique et des risques sécuritaires. Du fait de ces risques, les projets d’infrastructures peuvent être compromis par des changements politiques ou des conflits, ce qui nécessite des garanties solides contre ces risques. Un autre enjeu est celui de faire face à une absence de cadre juridique clair et prévisible. En effet, dans certains pays, l’absence de législation claire sur les PPP ou les concessions peut engendrer des incertitudes pour les investisseurs. Un cadre juridique stable est essentiel pour assurer la confiance des bailleurs de fonds et des investisseurs. Il convient d’ajouter à ces enjeux celui de la corruption et du manque de transparence. Malgré des progrès ici et là, la corruption reste un problème majeur dans certains pays africains. Des mécanismes juridiques de transparence et de lutte contre la corruption sont donc importants et nécessaires pour at- tirer les investisseurs étrangers. N’oublions pas de citer également l’enjeu des droits fonciers et de la gestion des ressources naturelles. Les projets d’infrastructures peuvent entrer en conflit avec des droits fonciers locaux ou la gestion des ressources naturelles, nécessitant une régulation stricte et transparente pour garantir la sécurité juridique.
Quel type de montage juridique est-il privilégié en Afrique, s’agissant des projets d’infrastructures : PPP, concession, marché public, régie directe… ? pourquoi ?
Dans ce contexte, les montages juridiques privilégiés pour les projets d’infrastructures en Afrique sont les Partenariats Public-Privé (PPP). Ces PPP sont de plus en plus utilisés, car ils permettent de combiner l’expertise et le financement privé avec l’implication de l’État pour garantir les services publics. Cependant, leur succès dépend de la capacité des gouvernements à offrir des garanties contre les risques poli- tiques et économiques. Les concessions sont également fréquentes, notamment dans les secteurs des transports et des services publics où elles offrent aux investisseurs une période de gestion exclusive de l’infrastructure avant de la restituer à l’État. Bien que plus administratifs, les marchés publics restent également courants dans certains pays, surtout pour des projets à court terme ou de moindre envergure. Enfin, la régie directe est parfois utilisée pour des projets où l’État préfère garder le contrôle total de l’infrastructure, mais elle est moins courante en raison des contraintes budgétaires. Les PPP et les concessions sont privilégiés car ils permettent de mobiliser des financements privés tout en assurant l’implication de l’État pour garantir la continuité des services publics.
Existe-t-il une régulation juridique des PPP dans le cadre de l’OHADA ? Si non, comment les investisseurs peuvent-ils sécuriser juridiquement un PPP contre les risques politiques ou sécuritaires ?
L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ne dispose pas d’un cadre juridique spécifique aux PPP. Cependant, des principes de base en matière de contrats et de procédures sont applicables, ce qui permet de sécuriser une partie des aspects juridiques des PPP. Pour sécuriser juridiquement un PPP contre les risques politiques ou sécuritaires, les investisseurs peuvent inclure des clauses de protection dans les contrats, telles que des garanties contre l’expropriation, des clauses de résiliation anticipée pour cause de force majeure, ou des assurances contre les risques politiques. Les investisseurs peuvent également chercher à inclure des mécanismes de résolution de conflits tels que l’arbitrage international.
Quelles sont, selon vous, les conditions pour que les PPP soient en Afrique, une option économiquement viable pour la fourniture d’infrastructures publiques ?
Avant tout, je dirai qu’un cadre juridique transparent et prévisible, ainsi qu’une stabilité politique, sont essentiels pour rassurer les investisseurs et garantir la pérennité des projets. Par ailleurs, les gouvernements doivent mettre en place des mécanismes pour partager équitablement les risques entre le secteur public et le secteur privé, notamment les risques liés à la monnaie, à la politique, et aux catastrophes naturelles. Pour que ces projets soient viables en Afrique, les gouvernements doivent également disposer des compétences et des ressources nécessaires pour gérer ces projets, notamment en matière de super- vision et de contrôle des contrats. Enfin, nous le soulignons précédemment, des mécanismes de transparence sont indispensables pour garantir que ces projets sont menés de manière efficace et honnête.
Quelles sont les modalités de règlement des différends dans les projets d’infrastructures ?
Entre le recours à l’arbitrage (institutionnel ou ad hoc) et un mode alternatif de règlement des litiges, lequel est le plus souvent privilégié ? Pourquoi ?
Le règlement des différends dans les projets d’infrastructures se fait généralement par un arbitrage (institutionnel ou ad hoc). Cette approche pour la résolution des disputes est privilégié dans la plupart des projets d’infra- structures en raison de sa capacité à offrir une solution rapide, impartiale et souvent plus efficace que les systèmes judiciaires nationaux, surtout dans les pays où les systèmes judiciaires peuvent être lents ou manquent d’indépendance. Notons que bien que moins courants que l’arbitrage, les modes alternatifs de règlement des différends, comme la médiation ou la conciliation, peuvent être utilisés pour résoudre les conflits à l’amiable. Mais l’arbitrage est généralement préféré car il permet aux parties de choisir des arbitres spécialisés dans les questions complexes liées aux infrastructures, ce qui peut conduire à une résolution plus rapide et plus technique des différends.
La Côte d’Ivoire est souvent montrée en exemple en matière de PPP en Afrique francophone. Pensez-vous que la législation ivoirienne régissant les PPP est mieux adaptée ? Donne-t-elle aux bailleurs de fonds et aux investisseurs potentiels les assurances voulues ?
La législation ivoirienne en matière de PPP est relativement bien développée, notamment avec la loi N° 2014-451 du 05 août 2014 relative aux contrats de PPP, qui encadre la mise en place et la gestion des PPP en Côte d’Ivoire. Cette législation offre un cadre juridique relativement sécurisé pour les investisseurs, avec des garanties concernant la transparence et la gestion des contrats. Pour autant, des défis subsistent concernant la mise en œuvre effective de cette législation et la gestion des risques politiques ou économiques.
Les investisseurs peuvent chercher à sécuriser leurs investissements en incluant des clauses spécifiques dans les contrats, comme des assurances contre les risques politiques ou des garanties de performance.
En d’autres mots, bien que la législation ivoirienne fournisse un cadre juridique adapté aux PPP, des efforts supplémentaires dans le temps restent nécessaires pour garantir la sécurité juridique des investisseurs et assurer la mise en œuvre efficace des projets.
Propos recueillis par A.C. DIALLO – ©Magazine BUSINESS AFRICA



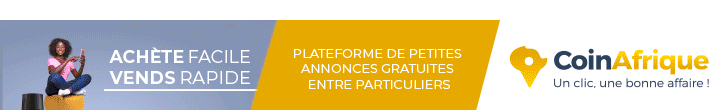

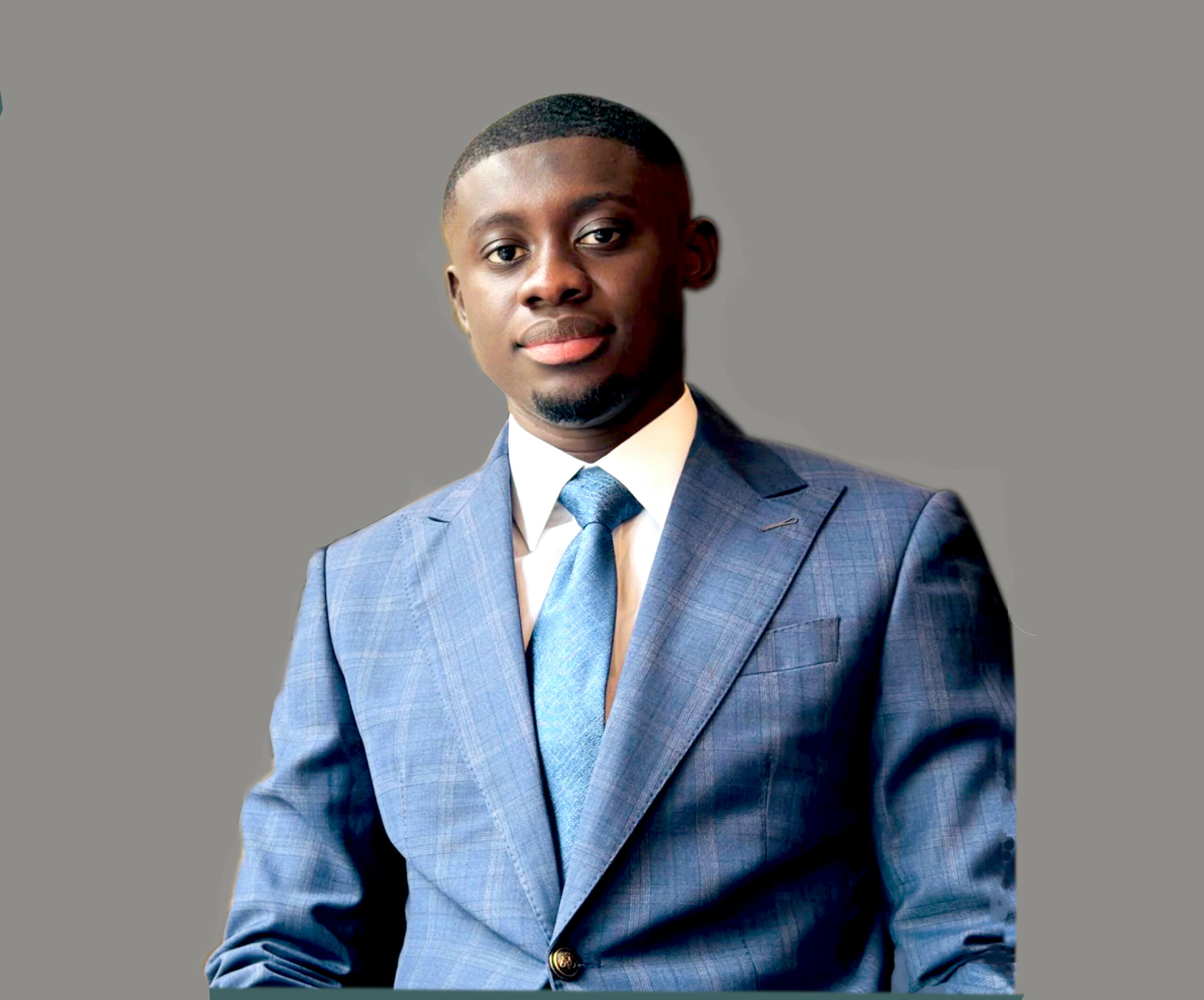









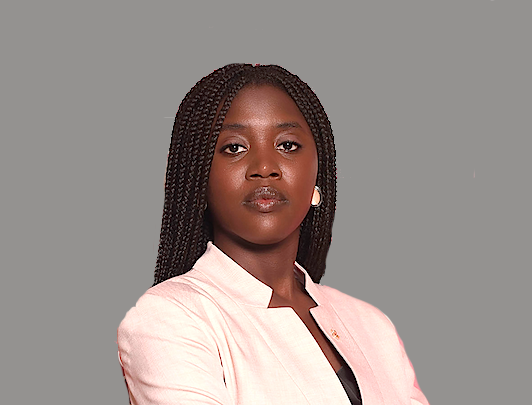


Laisser un commentaire