L’Impact Investing ou investissement à impact, apparait aujourd’hui comme l’une des nouvelles formes d’engagement sociétal des acteurs économiques.
S’inspirant des principes des Nations Unies sur les droits humains mais également de l’Economie sociale et solidaire, il est une réponse aux attentes des populations du continent africain et des gouvernements engagés notamment en matière d’inclusion et de développement durable.
Qu’est ce qui distingue ce type d’investissement des autres ? Comment mesure t-on l’impact de l’investissement ? Quels sont les secteurs les plus concernés?
Pour répondre à ces questions, le Magazine BUSINESS AFRICA a sollicité le concours d’une des meilleures expertes de l’investissement d’impact: Mme Pierrette KOUAKOU, Associé-Gérant de Stone Consulting Group. INTERVIEW
Tout d’abord, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours académique et professionnel ?
Merci pour cette lucarne que vous offrez sur le monde de l’investissement à impact.
Mon parcours est en effet marqué par une conviction profonde : la finance doit être un outil de développement.
Après des études en Management et Commerce International à l’INSTEC, j’ai rejoint le secteur bancaire chez UBA Côte d’Ivoire, où j’ai piloté des portefeuilles publics et institutionnels. Mais c’est en prenant la direction de FIN’Elle, une institution dédiée aux femmes entrepreneures, que j’ai mesuré le pouvoir transformateur de la microfinance. Croître un bilan de 18 à 30 milliards FCFA tout en triplant le nombre de clientes, c’est la preuve que performance économique et impact social sont indissociables.
Ce qui m’anime ? Voir une commerçante passer de l’informel à un compte bancaire, puis à un crédit pour développer son activité.
Ces réussites concrètes montrent que l’inclusion financière n’est pas un concept abstrait, mais un accélérateur de développement.
Quand on parle d’investissement à impact, de quoi s’agit-il concrètement ?
C’est un investissement qui refuse le dilemme entre rentabilité et utilité.
Concrètement, c’est financer notamment « Okedjenou », une entreprise Ivoirienne spécialisée dans la transformation et la valorisation du manioc en Attiéké déshydraté (semoule de manioc) qui s’approvisionne auprès de coopératives de femmes à Bingerville et Toumodi. Elle contribue à leur autonomisation en les formant aux normes de qualité et au conditionnement tout en soutenant la scolarisation des enfants de la communauté.
L’exigence ? Mesurer l’impact réel et social, pas seulement les dividendes.
Pour développer nos économies de manière durable l’argent seul ne suffira pas.
Prenez l’exemple d’un producteur de cacao : un investissement à impact, c’est lui proposer à la fois un financement pour ses récoltes ET des formations sur l’agriculture durable et soutenir la scolarisation de ses enfants et lui assurer une couverture santé minimum.
C’est réduisant sa vulnérabilité que nous arriverons a sécuriser le remboursement de ses engagements.
Ainsi, on améliore ses revenus tout en préservant les sols et son bien-être familial. C’est cette double logique qui change la donne. Les institutions comme la BAD et AGF (Africa Guarantee Fund) l’ont compris avec des initiatives comme AFAWA, qui combine capitaux et renforcement des capacités.
Existe-t-il une méthodologie reconnue et de mesure de l’impact des investissements ?
Absolument. La mesure d’impact est la colonne vertébrale de l’investissement à impact, sans elle, nous retombons dans les promesses creuses.
Plusieurs méthodologies rigoureuses se sont imposées :
•Les standards IRIS+ du GIIN (Global Impact Investing Network) : C’est le cadre le plus utilisé, avec plus de 600 indicateurs quantifiables.
•Les ODD des Nations Unies : Un langage universel qui constitue une référence universelle
•L’évaluation qualitative : Qui consiste à tracer tout le parcours d’impact – depuis le prêt jusqu’à ses effets sur la scolarisation des enfants des bénéficiaires.
•Les normes B Corp et EDGE : Particulièrement utiles pour évaluer l’impact social des entreprises soutenues.
Le vrai défi ? Standardiser ces mesures au niveau continental. C’est pourquoi je plaide pour la création d’un label africain d’impact, calibré pour nos réalités locales.
Car ce qui compte finalement, ce ne sont pas les chiffres bruts, mais leur traduction concrète dans la vie des Africains.
Quel regard portez-vous sur l’évolution de ce type d’investissement, notamment en Afrique francophone ?
L’évolution de l’investissement à impact en Afrique francophone est à la fois encourageante et révélatrice de défis persistants. Trois observations clés :
•Une croissance significative mais inégale
Le marché a triplé depuis 2015, avec des engagements dépassant 2,3 milliards USD en 2023. Nous notons toutefois une forte concentration de ces investissements sur Sénégal et la Côte d’Ivoire.
Notre expérience dans la microfinance montre pourtant que les besoins sont universels et commun a toute l’Afrique.
Notre modèle de financement inclusif dédié pourra être déployée partout en Afrique francophone et même en Afrique.
•L’émergence d’acteurs locaux structurants
Des institutions comme la CNPS en Côte d’Ivoire ou le FONSIS au Sénégal intègrent désormais des critères d’impact dans leurs stratégies.
•L’innovation technologique : le vrai changement vient des fintechs : des plateformes comme JEKO Gestion des recettes et de la comptabilité des petite commerçante (Côte d’Ivoire) ou MaTontine (Sénégal) redéfinissent les règles du jeu avec des solutions hybrides profit-impact.
En Europe et aux Etats-Unis, l’investissement à impact se concentre principalement sur les enjeux climatiques et de protection de l’environnement.
Quels sont, en Afrique, les principaux secteurs d’intervention de l’investissement d’impact ?
En Afrique, l’investissement à impact épouse les priorités de développement immédiates de nos populations, tout en préparant l’avenir. Voici les cinq secteurs clés où il fait la différence :
•Inclusion financière digitale
•Agriculture résiliente
•Énergie décentralisée avec l’Energie solaire
•Santé communautaire avec des solutions d’assurances collectives dans le milieu rural
•Formation professionnelle aux métiers de la transformation énergétique et digital pour le soutien aux PME.
Contrairement à l’Occident, près de 60% de ces investissements ciblent directement l’autonomisation des femmes et des jeunes. C’est là que réside notre plus grand levier de transformation, chaque argent investi dans une femme entrepreneure génère un retour social multiplié par 5 dans sa communauté selon la Banque Mondiale.
Comment, selon vous, l’investissement à impact peut-il être un instrument de croissance économique pour les pays africains ?
L’investissement à impact est bien plus qu’un simple outil de financement – c’est un véritable catalyseur de croissance économique pour l’Afrique, et voici pourquoi de manière concrète :
•Il attire des capitaux étrangers : Les fonds d’impact ont mobilisé 6,4 milliards $ en Afrique en 2022
•Il comble le déficit de financement des PME à travers le financement des microfinances colonne vertébrale de nos économies (Les PME africaines représentent 80% des emplois mais n’accèdent qu’à 20% du crédit bancaire). En 2023 la CDC-CI a financé les PME dans les secteurs de la transformation des produits locaux, l’entreprenariat féminin et les secteurs prioritaires par une convention avec des Microfinances locales.
•Il transforme les secteurs clés par l’innovation : Dans l’agriculture les plateformes de digital ont augmenté les revenus des paysans de 40-60% grâce à l’Energie solaire et à l’accès au marché
•Dans l’énergie : les solutions solaires réduisent les coûts énergétiques de 60% pour les artisans
•Il crée des écosystèmes économiques résilients
•Les fintechs comme Wave ont permis une inclusion financière 3 fois plus rapide qu’avec les banques traditionnelles.
Comment se prémunir de l »impact washing », cette pratique trompeuse des entreprises qui prétendent avoir un impact positif sur des enjeux sociaux ou environnementaux sans réellement agir de manière substantielle ?
La transparence est non-négociable.
Il faut des standards contraignants : rapports audités par des tiers, alignement sur les ODD, et surtout, écouter les bénéficiaires. Une entreprise qui prétend soutenir l’agriculture durable mais ignore les petits producteurs ne saurai mesurer la profondeur de son impact. Les labels comme B Corp ou les certifications locales doivent devenir la norme.
Les investisseurs à impact on l’obligation de tracer chaque argent engagé, depuis le financement jusqu’aux résultats sur le terrain.
Les technologies blockchain et les FinTech pourraient d’ailleurs révolutionner cette traçabilité. La sanction des pratiques abusives est naturellement le risque de réputation qui transforme une initiative noble et pratique non équitable. C’est justement face à ces pratiques que nous Stone Consulting Group accompagnons les investisseurs à impact afin d’élaborer des programmes d’assistances techniques et financiers actionnables à l’échelle nationale tout en mettant à leur disposition des outils de suivi et de mesures technologiques fiables.
Quel est votre sentiment sur l’état de la réglementation concernant l’investissement à impact en Afrique, notamment francophone. Les dispositifs d’encadrement juridique et règlementaire du secteur, vous semblent-ils adaptés ?
La réglementation de l’investissement à impact en Afrique francophone est à un tournant critique, avec des avancées réelles mais encore insuffisantes face à l’urgence des besoins.
Sur le plan national, la Côte d’Ivoire a adopté en 2021 un cadre pour les obligations vertes. Le Sénégal a créé le FONGIP qui soutient les PME et les projets solidaires.
L’UMOA encourage l’ intégration des critères ESG dans ses projets communautaires.
Cependant, de nombreux défis persistent sur le plan régional, relativement à l’uniformisation des mesures et les exigences de « reporting » qui varient d’un pays a un autre et selon les bailleurs.
De même, les exigences souvent sur les modèles européens, peu adaptés à nos réalités terrain et excluent les PME qui manquent de ressources qualifiées.
A date, nous ne disposons pas de dispositif de contrôles qui sanctionnent l’impact washing. Seulement 10% des institutions financières publient des rapports d’impact audités.
Comme piste d’amélioration concrète, nos régulateurs devront encadrer et harmoniser l’investissement à impact par la création d’un référentiel commun au sein de la zone UEMOA et standardiser les indicateurs clés tels (L’inclusion financière réel, le taux de création d’emplois qualitatifs…)
La mise en place des « comités d’impact » indépendants dans chaque pays et l’instauration de la certification par des auditeurs Africains agrées constituerai un cadre de contrôle pour le développement des investissements à impact vers la région.
L’Afrique francophone doit développer son propre modèle régulatoire, ni trop laxiste (pour éviter le greenwashing) ni trop rigide (pour ne pas étouffer l’innovation).
On note, en Afrique, une très faible proportion d’actifs chez les investisseurs (notamment institutionnels) dédiés aux fonds à impact et, parfois, l’absence d’une demande formulée par ces investisseurs aux fonds à impact pour qu’ils mesurent leur impact. Comment, selon vous, inverser la tendance ?
Cette situation reflète un paradoxe africain : alors que nos économies ont le plus grand besoin d’investissements à impact, nos investisseurs institutionnels y consacrent moins de 5% de leurs actifs (contre 15-20% en Europe).
Pour inverser cette tendance, je propose une feuille de route concrète en 4 axes:
•Démystifier la rentabilité de l’impact en démontrant avec des chiffres la corrélation entre l’évolution durable de la rentabilité et l’investissement à impact, nous avons démontrer à FIN’Elle en formant les femmes et les accompagnant vers la formalisation, elles arrivaient à accéder à des marchés et intégrer des chaines de valeur à forte valeur ajoutée.
De même l’institution a triplé sa base clientèle en 3 ans grâce au programme IFF (Inclusion Financière, Formation et Financement)
•Réformer l’environnement réglementaire Par des incitations intelligentes et la collecte de données mesurables.
•Structurer l’offre locale (Par des instruments adaptés) par le développement de fonds privés locaux avec l’appui des Etats pour la démocratisation des initiatives locales
•Lancer des produits clés-en-main : « Obligations femmes entrepreneures » indexées sur les ODD 5 et 8
•Digitaliser le reporting : Plateforme commune type « Impact Dashboard Africa » avec données standardisées
•Mobiliser la diaspora et les populations par des produits d’épargne impact labellisés
L’Afrique ne peut plus se contenter de suivre, elle doit créer la voie en inventant son propre modèle d’investissement institutionnel à impact.
Les outils existent, les besoins sont criants : il ne manque que la volonté stratégique de passer à l’échelle.
Interview réalisée par A.C. DIALLO – ©Magazine BUSINESS AFRICA

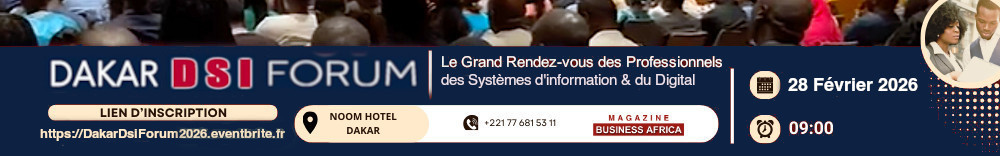

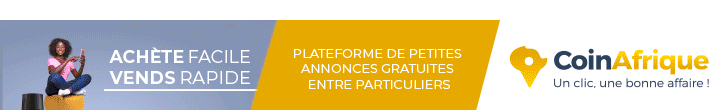














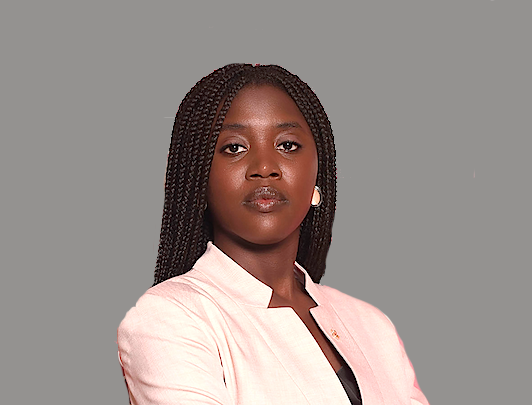


Laisser un commentaire