Maître Diabaté a débuté sa carrière au sein de JP Morgan Chase à Luxembourg dans le domaine des fonds d’investissement. Il a ensuite exercé à la Banque Internationale du Luxembourg (BIL) en tant qu’administrateur conformité (compliance administrator), avant de rejoindre un cabinet d’avocats local. En 2010, il a occupé le poste de directeur juridique au sein d’une fiduciaire, puis a créé sa propre fiduciaire en 2013. En 2017, il a renoué avec sa profession d’avocat en se réinscrivant au barreau, consolidant ainsi son expertise juridique et son engagement envers ses clients.
En quoi, sur le plan juridique, le financement de projets d’infrastructures peut-il paraître spécifique ?
Les projets d’infrastructures sont, par définition, des ensembles d’installations ou d’équipements essentiels pour répondre aux besoins d’une collectivité. Ces projets se distinguent généralement par leur ampleur, qu’il s’agisse de la taille des travaux ou de l’importance des financements nécessaires.
Leur financement, souvent substantiel, nécessite un encadrement juridique rigoureux afin de garantir une protection optimale des intérêts des investisseurs et des États.
Les contrats encadrant ces projets, fréquemment structurés sous forme de partenariats public-privé (PPP), doivent intégrer plusieurs dimensions : la taille et la durée des travaux en tenant compte des aléas de construction, la multiplicité des intervenants et partenaires (publics et privés), la diversité des sources de financement, ainsi que les risques politico-économiques et financiers (notamment ceux liés aux taux d’intérêt, aux fluctuations monétaires et à l’inflation).
En outre, il est indispensable d’assurer une sécurité juridique, en particulier en matière foncière qui est un enjeu clé dans le contexte africain, et de veiller à respecter les engagements internationaux en matière environnementale, notamment ceux liés à la transition énergétique.
Quels sont, en Afrique, les principaux enjeux juridiques liés au financement de projets d’infrastructures ?
Il convient de souligner que le déficit en infrastructures constitue un défi majeur en Afrique. L’urbanisation rapide, le changement climatique et divers enjeux mondiaux exercent une pression croissante sur les gouvernements locaux, qui peinent à fournir des infrastructures et des services urbains de qualité suffisante pour répondre aux besoins des populations en constante augmentation.
Malgré les efforts considérables des États africains, une insécurité juridique persiste, notamment en ce qui concerne le droit de propriété ainsi que les cadres politique, économique et social. Cette situation est aggravée par des facteurs tels que les coups d’État, les troubles sociaux et autres événements déstabilisateurs qui menacent l’équilibre des accords juridiques entre les parties impliquées.
La qualité des parties prenantes, qu’elles soient publiques, privées ou internationales , et le recours fréquent au financement étranger, en raison des contraintes budgétaires des États, complexifient davantage la négociation et la rédaction des contrats.
Par ailleurs, les problématiques de gouvernance, notamment la corruption, viennent allonger la liste des défis juridiques à relever dans ce domaine.
Quel type de montage juridique est-il privilégié en Afrique, s’agissant des projets d’infrastructures : PPP, concession, marché public, régie directe… ? pourquoi ?
Le partenariat public-privé (PPP) constitue un cadre contractuel à long terme, établissant une collaboration entre le secteur public et le secteur privé pour la conception, la construction, le financement, l’exploitation et l’entretien d’infrastructures.
Ce modèle, largement adopté, offre une réponse adaptée aux défis économiques des États africains.
En ayant recours aux investissements privés, le PPP permet aux États de limiter leur endettement, en opposition aux régies directes, où le financement repose exclusivement sur les ressources publiques. Il constitue également un levier stratégique pour mobiliser l’expertise et les ressources du secteur privé dans la réalisation de projets d’envergure.
Ce partenariat favorise non seulement la diversification économique, mais également l’amélioration de la compétitivité nationale grâce à une infrastructure modernisée, renforçant ainsi le commerce, l’industrie et les secteurs connexes comme la construction, l’équipement ou les services de soutien.
Enfin, l’un des principaux avantages du PPP réside dans la répartition des bénéfices et, surtout, des risques. Ces derniers, notamment ceux liés à la gestion des projets, sont partagés entre les parties, garantissant un équilibre des responsabilités et une meilleure gestion des aléas.
Existe-t-il une régulation juridique des PPP dans le cadre de l’OHADA ? Si non, comment les investisseurs peuvent-ils sécuriser juridiquement un PPP contre les risques politiques ou sécuritaires ?
À ce jour, il n’existe pas, à ma connaissance, de cadre juridique uniforme au sein de l’OHADA encadrant spécifiquement les partenariats public-privé (PPP).
Ces derniers sont principalement régis par les législations nationales des États membres, chacun appliquant ses propres règles et exigences en la matière.
Dans un contexte marqué par des aléas politico-sécuritaires fréquents, les investisseurs, soucieux de sécuriser leurs engagements, peuvent exiger des garanties contractuelles spécifiques. Parmi celles-ci figurent les garanties étatiques, ainsi que des assurances couvrant les risques politiques tels que les guerres, les troubles civils ou encore les expropriations.
De plus, le choix de la juridiction compétente en cas de différend revêt une importance capitale. Il est courant que les parties optent pour une juridiction étrangère perçue comme neutre et impartiale, telles que la Chambre Arbitrale Internationale de Paris, qui bénéficie d’une réputation d’expertise et d’équité dans le règlement des litiges internationaux.
Quelles sont, selon vous, les conditions pour que les PPP soient en Afrique, une option économiquement viable pour la fourniture d’infrastructures publiques ?
Le partenariat public-privé (PPP) se présente aujourd’hui comme l’un des moyens les plus efficaces pour la réalisation de projets d’infrastructures en Afrique.
Son caractère hybride, qui repose sur un partage des risques entre les parties publiques et privées, offre aux États africains une solution adaptée aux enjeux de financement, de gestion et de développement des infrastructures.
Cependant, la mise en œuvre de projets en PPP repose sur plusieurs conditions essentielles. Parmi celles-ci figurent la stabilité économique et politique, la promotion de la bonne gouvernance et l’existence d’un cadre juridique clair et prévisible, garantissant notamment la protection des investisseurs privés.
Il est tout aussi crucial que les projets soient attractifs et qu’ils respectent les normes internationales, tant sur le plan social qu’environnemental, afin de répondre aux exigences de la transition écologique et au respect des droits fondamentaux.
Créer un environnement de confiance pour les investisseurs privés est fondamental.
Ces derniers, étant souvent les porteurs des principaux risques, nécessitent des garanties solides et un climat propice à la sécurisation de leurs engagements financiers et opérationnels.
Quelles sont les modalités de règlement des différends dans les projets d’infrastructures ? Entre le recours à l’arbitrage (institutionnel ou ad hoc) et un mode alternatif de règlement des litiges, lequel est le plus souvent privilégié ? Pourquoi ?
L’arbitrage constitue le mode de résolution des différends le plus privilégié dans le cadre des projets impliquant des partenariats public-privé (PPP), en raison de ses caractéristiques distinctives. Sa force réside dans son caractère final et exécutoire, garantissant une résolution rapide et efficace des conflits.
De plus, sa confidentialité, souvent recherchée par les États, protège la sensibilité des informations liées aux différends contractuels.
L’arbitrage offre également une neutralité qui en fait une solution appréciée des investisseurs étrangers, permettant d’assurer une équité dans le traitement des litiges, loin des potentielles influences locales.
En outre, le processus de désignation des arbitres est démocratique et impartial, renforçant ainsi la confiance des parties dans le mécanisme.
Toutefois, il est important de noter que l’arbitrage peut s’avérer long et onéreux, ce qui peut constituer un obstacle, en particulier pour les petites parties contractantes.
Ces coûts et délais doivent être minutieusement évalués dans le cadre de la négociation des accords afin d’assurer une solution optimale pour toutes les parties concernées.
Vous êtes originaire de la Côte d’Ivoire, la législation ivoirienne régissant les PPP et leur financement, est-elle selon vous adaptée ? Donne-t-elle aux bailleurs de fonds et aux investisseurs potentiels les assurances voulues ?
Fort de mon expérience dans la négociation d’un partenariat public-privé (PPP) avec le gouvernement ivoirien, je peux confirmer que la Côte d’Ivoire dispose d’un cadre juridique adapté et rassurant pour les investisseurs.
Le décret de 2018, régissant les règles relatives aux contrats de PPP, établit des dispositions claires et transparentes, notamment en ce qui concerne les procédures de passation des marchés.
La Côte d’Ivoire privilégie l’appel d’offres afin de prévenir les risques de clientélisme et de corruption, renforçant ainsi la crédibilité de son cadre juridique.
Ce décret offre également un cadre structuré pour le contenu des contrats, garantissant une certaine prévisibilité et sécurité juridique. De plus, les autorités ivoiriennes se montrent flexibles dans l’interprétation des clauses contractuelles et dans la gestion des difficultés pouvant survenir lors de l’exécution des obligations des parties.
Cette souplesse, souvent orientée en faveur des investisseurs, traduit une approche résolument « Business Friendly » adoptée par la Côte d’Ivoire.
Cependant, des défis persistent, en particulier celui de l’insuffisance de garanties face aux risques socio-politiques.
L’instauration de mécanismes de protection adaptés pour pallier ces risques contribuerait à accroître la compétitivité des États africains, renforçant leur attractivité pour les investisseurs.
Ce défi, d’une importance cruciale, concerne de nombreuses nations africaines, qui, il convient de le rappeler, demeurent des démocraties relativement jeunes.
Propos recueillis par A.C. DIALLO – ©Magazine BUSINESS AFRICA

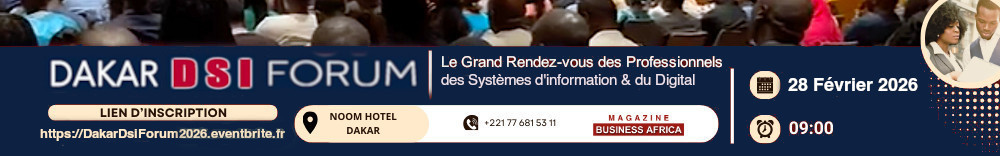

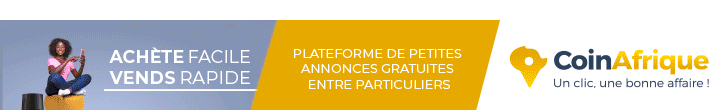















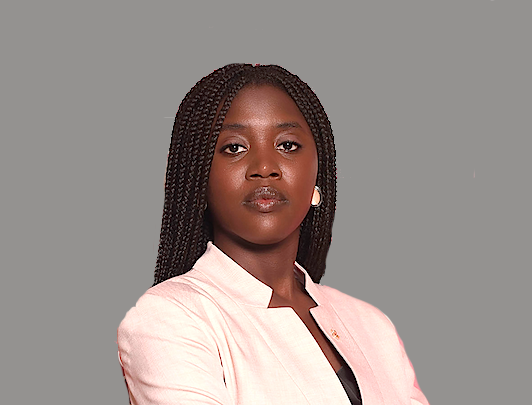


Laisser un commentaire