Considérée comme l’une des avocates fiscales les plus en vue en Afrique, Lia LOUMIGOU TSHIBEMBA a exercé au sein de grands cabinets parisiens avant de rentrer en République Démocratique du Congo. Première femme partner Tax and Legal d’un big 4 en RDC, son conseil est sollicité sur les problématiques fiscales nécessitant une expertise aiguisée. INTERVIEW
Tout d’abord, quel regard portez-vous sur l’évolution de la fiscalité en Afrique, notamment dans sa
partie francophone sub-saharienne ?
La législation fiscale en Afrique francophone est relativement similaire par les directives de l’UEMOA
qui s’imposent aux Etats de l’Afrique de l’Ouest et celles de la CEMAC pour l’Afrique centrale et de
l’appartenance des dirigeants fiscaux à diverses institution ou organismes, tels le CREDAF, l’ATAF,
l’OCDE, etc.
Ainsi du côté de la fiscalité directe, les Etats se sont orientés vers une distinction entre l’imposition des
sociétés et l’imposition des personnes physiques, permettant notamment d’assurer une imposition équitable entre personnes physiques.
Si on se focalise sur la RDC (un environnement que je connais), avec la loi n°23/053 du 30 novembre
2023 relative l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur les revenus des personnes physiques et la loi n°
23/052 du 30 novembre 2023 portant réforme des procédures fiscales qui actualise les procédures au
regard de la mise en oeuvre de la loi précitée, lois qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026, la RDC
normalise sa situation en se conformant aux standards internationaux. En effet, encore aujourd’hui les
sociétés sont responsables du paiement des impôts des personnes physiques qu’elles emploient.
Concernant la fiscalité indirecte, comme dans la plupart dans le monde, les pays d’Afrique
francophone ont mis en place la taxe sur la valeur ajoutée. S’agissant de la RDC, dont le texte a été
élaboré avec l’appui du FMI, la TVA est entrée en vigueur au 1er janvier 2012.
Entre la RDC et les pays d’Afrique francophone les différences suivantes subsistent :
1- Au niveau de l’organisation du système fiscal :
La plupart des Etats francophones disposent de deux entités pour la gestion des impôts, à savoir la
direction générale des impôts qui traite de la fiscalité interne et la direction générale des douanes
et accises.
Certains pays ont mis en oeuvre une agence des revenus qui a sous sa compétence les deux
directions précitées. C’est ainsi que l’Ile Maurice, le Togo, le Burundi et Madagascar ont mis en
oeuvre cette structure démontrant ainsi que les missions autres que fiscales confiées à la douane
n’empêchent pas la création d’une telle agence ;
La RDC plutôt que de s’orienter vers la fusion des services, a créé 3 directions en ajoutant à la
direction générale des impôts et à la direction générale des douanes et accises, une direction qui
traite des actes générateurs de recettes non fiscales, la Direction Générale de Recettes
Administratives, Judiciaires, Domaniales et de participations (DGRAD).
Cette direction gère les taxes et redevances dues par les citoyens pour obtenir des attestations,
autorisations, certificats, duplicatas, passeport, permis, visas, etc. autant d’actes répartis sur
l’ensemble du territoire dont la quotité qui reflète le coût de réalisation est relativement peu
élevée. Pour assurer le fonctionnement de cette direction, diverses droits et taxes touchant les
opérateurs économiques ont dû lui être alloués dont le rendement assure environ 90% de ses
recettes. Il convient toutefois de noter que tant la nomenclature du manuel des finances publiques
du FMI que celle de l’OCDE prennent en compte ces différents droits et taxes imputés au secteur
privé dans la catégorie des recettes fiscales.
Cette dichotomie des structures de gestion au niveau de la fiscalité interne (DGI/DGRAD) consacre
l’éclatement de la gestion du dossier fiscal du contribuable, pourtant gage de la performance de la
mobilisation des recettes. A cet égard, la nomenclature en vigueur actualisée des lois de finances
ultérieures à l’exercice 2018 compte ainsi 261 actes générateurs, les taux des droits, taxes et
redevances à percevoir étant fixés par arrêté interministériel de chaque ministre sectoriel et du
ministre des Finances.
Par ailleurs, la RDC étant décentralisée, au niveau local, les Provinces disposent de compétences
fiscales exclusives et de compétences partagées avec le Pouvoir central, ce qui a conduit à la
création d’une Direction Générale des Recettes Provinciales dans chacune des 26 Provinces que
compte le pays. En outre, la Province étant constituée d’Entités territoriales Décentralisées (ETD),
les villes, communes, secteurs et chefferies, chacun disposant de compétences.
En conclusion, comme vous pouvez le constater avec la multiplicité de ses services, le système
congolais ne permet pas une politique fiscale cohérente, a un coût financier prohibitif et les
opérateurs économiques se plaignent des tracasseries qui en résultent.
2- Au niveau de la digitalisation
Au niveau des finances, la RDC s’attèle à combler son retard par rapport aux autres pays de la sous-
région.
En effet, au niveau des recettes, seule la Direction gén├®rale des douanes et accises, gr├óce ├á Sydonia
world en cours d’opérationnalisation dans tous les bureaux de douane, peut assurer une gestion
sur base des droits constatés.
La DGI, en attendant l’implémentation en cours d’un ERP (Enterprise Planning System) fonctionne sur
base caisse. Enfin, le logiciel LOGIRAD développé à la DGRAD en cours de déploiement dans les
services permettra de gérer plus efficacement les recettes non fiscales sur base des droits constatés.
Au niveau du suivi des opérations financières de l’Etat, il est à noter la création de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) par décret N°22-12B du 31 mars 2022, dont
l’opérationnalisation est en cours et qui devrait aboutir à la mise en place du réseau national des
comptables publics dont l’objectif est d’enregistrer toutes les op├®rations financières réalisées sur le
territoire avec une centralisation au niveau de l’Agence Comptable Central du Trésor (ACCT).
L’opérationnalisation de la DGTCP constitue un préalable à la mise en place des budgets- programmes
prévus par la loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques (LOFIP) dont la mise en oeuvre prévue au 1er janvier 2020 a été reportée au 1er janvier 2024 puis au 1er janvier 2028.
Les progrès de la technologie cellulaire sans fil qui offre des vitesses de chargement et de
téléchargement plus élevées, des connexions plus cohérentes et une capacité améliorée par rapport
aux réseaux précédents, sont de nature à favoriser le comblement du retard des services de l’Etat.
On parle de grande disparité de taux de pression fiscale suivant les pays africains. Cette affirmation
est-elle fondée ?
Je le confirme. La dernière édition de la brochure sur les statistiques des recettes publiques en Afrique
publiée par l’OCDE en 2023 portant sur les revenus de l’exercice 2021 renseigne pour les 33 pays
participant à cette initiative un taux moyen de 15,6%. Il est de 19,8% dans les pays d’Asie Pacifique,
21,7% dans les pays d’Amérique latine et de 31,4% dans les pays de l’OCDE.
En Afrique, le taux de pression fiscale va de 5,9% en Guinée équatoriale à 32,5% en Tunisie. 19 Etats
sont en dessous de la moyenne et 14 sont au-dessus.
Cette disparité dans les taux de pression fiscale reflète la diversité des politiques fiscales mises en
oeuvre.
En effet, le taux de pression fiscale ciblé pour un pays ne disposant pas de ressources naturelles est de
17%. Il est de 20% pour un pays disposant de ressources naturelles et de 24% pour un pays producteur de pétrole.
Concernant la RDC, ne sont pas renseignées les recettes des comptes spéciaux et de divers
établissements publics qui bénéficient de prélèvements obligatoires pour leur fonctionnement de
même que les recettes mobilisées par les provinces et entités territoriales décentralisées dans le cadre
de leurs compétences exclusives ou partagées allouées par la Constitution. Autrement dit, le taux de
pression fiscale de la RDC est significativement sous-évalué de l’ordre de 5% en 2024.
La question des Prix de Transfert revêt aujourd’hui une importance particulière dans la pratique
fiscale internationale et suscite beaucoup de remous. Pourquoi selon vous ?
Les 100 plus grandes sociétés mondiales n’ont jamais pesées aussi lourd en bourse, leur capitalisation
boursière a ainsi atteint en 2018 plus de 20.000 milliards de dollars et cela ne continue qu’à
augmenter. Ces grands groupes ayant des liens de dépendance directs ou indirects dans la plupart des
pays, la question du prix de pleine concurrence se pose donc avec acuité dans le cadre des relations
intragroupes.
En Afrique subsaharienne, comme ailleurs, les directions des grandes entreprises formatées pour la
gestion des plus grosses entreprises recouvrent de l’ordre de 80% des impôts, droits et taxes. Tel est le
cas notamment en RDC où la plupart des entreprises dans les secteurs des mines, des
télécommunications, de l’environnement, sont des filiales de groupes mondiaux.
C’est la raison pour laquelle la fiscalité internationale prend plus que jamais un nouvel essor dans le
domaine des livraisons de biens et la réalisation de prestations de services puisque sans création
d’établissement stable dans le pays consommateurs, elles induisent des pertes fiscales au niveau de
cette juridiction.
Signe important de cette émulation qui existe autour des prix de transfert, la RDC a signé, en
septembre 2024, deux conventions fiscales sous l’égide de l’OCDE qui visent à lutter contre l’érosion
de la base d’imposition et le transfert des bénéfices (BEPS) ainsi qu’à renforcer l’assujettissement
l’impôt (RAI).
Certains juristes affirment que les prix de transfert ne sont pas fondamentalement une matière
fiscale mais une question économique. Adhérez-vous à cette thèse ?
Oui et non ! Le respect du prix de pleine concurrence entre entreprises est une question économique.
Cependant, les prix de transfert ont, par les choix opérés par les entreprises liées inévitablement, des
incidences fiscales. Maitriser cette matière nécessite donc un jeu d’équilibriste entre l’économie et
fiscalité.
Estimez-vous qu’en général la règlementation régissant les prix de transfert, en Afrique est plutôt
équilibrée ou pensez-vous qu’elle nuit à l’investissement étranger ?
La règlementation régissant les prix de transfert est plutôt équilibrée. Toutefois, la question s’agissant
d’une nouvelle problématique en Afrique est la maitrise des vérificateurs de ce domaine qui est assez
nouveau dans nos environnements.
A cet égard, en RDC, une cellule prix de transfert a été créée au sein de la DGI dans le but de maitriser
ce sujet. Son renforcement en expertise permettra de répliquer les connaissances aux services de base
afin d’obtenir la mise à disposition de ressources financières supplémentaires, notamment pour
disposer d’informations sur les comparables.
Que pensez-vous de l’adoption des règles de l’OCDE sur la digitalisation de l’économie sans cesse
grandissante, dénommées sous le vocable de Pilier I ?
Les activités de distribution constituent l’une des situations les plus fréquemment rencontrées par les
entreprises multinationales dans les juridictions où elles exercent leurs activités.
La réforme, qui visait initialement les multinationales du numérique, a été progressivement élargie à
tous les secteurs, à l’exception des activités extractives et des services financiers régulés.
Les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires annuel consolidé de plus de 20 milliards d’euros et un
taux de bénéfices supérieur à 10% sont dans le champ d’application du Montant A du Pilier 1.
25 % du profit consolidé résiduel (soit la part excédant le seuil de 10 % de rentabilité) de ces
groupes serait attribués aux juridictions de marché, en fonction du chiffre d’affaires réalisé dans
chacun de ces territoires dans lesquels les consommateurs de biens sont situés ou les services sont
fournis.
Selon les données recueillies par l’OCDE (communiqué de presse publié par l’OCDE le 19 février 2024),
les litiges en matière de prix de transfert liés aux activités de distribution représentent une part
substantielle, entre 30 et 70%, de l’ensemble des litiges dans les juridictions à faibles capacités. Le
Montant B cherche ainsi et pour ces activités à garantir une plus grande prévisibilité fiscale, à réduire
les coûts administratifs et de compliance, et à assister ces juridictions en proposant des solutions
pratiques adaptées à leurs défis spécifiques.
Le mispricing c’est à dire la minoration ou la majoration de prix par une multinationale à l’effet
de tirer profit d’une situation fiscale, semble être une pratique de plus en plus utilisée. Quelles
peuvent en être les conséquences sur le plan juridique ?
La majoration inadéquate des prix par une entreprise établies en RDC conduit à des sanctions pénales.
Pour les multinationales, la minoration ou la majoration de prix dans le but profiter au niveau de
l’imposition de la matière ou de la filiale a pour conséquence la mise en oeuvre de l’acte anormal de
gestion.
Le principe de pleine concurrence posé par l’OCDE, qui repose sur la présence physique dans un
Etat, est-il encore pertinent, dans un contexte marqué par la digitalisation de l’économie ?
Oui le principe de pleine concurrence posé par l’OCDE reste pertinent surtout au regard de certaines
activités. En effet, les activités extractives et les services financiers régulés n’entrent pas dans le champ
d’application de la réattribution aux juridictions de marché, du fait pour le secteur minier de la
nécessité d’être présent sur le territoire et pour les services financiers de l’obligation l’égale de
disposer d’un établissement stable.
Propos recueillis par A.C. DIALLO – ®Magazine BUSINESS AFRICA



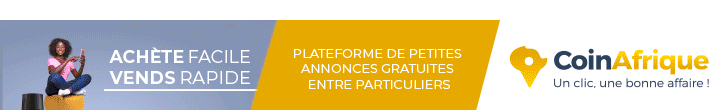

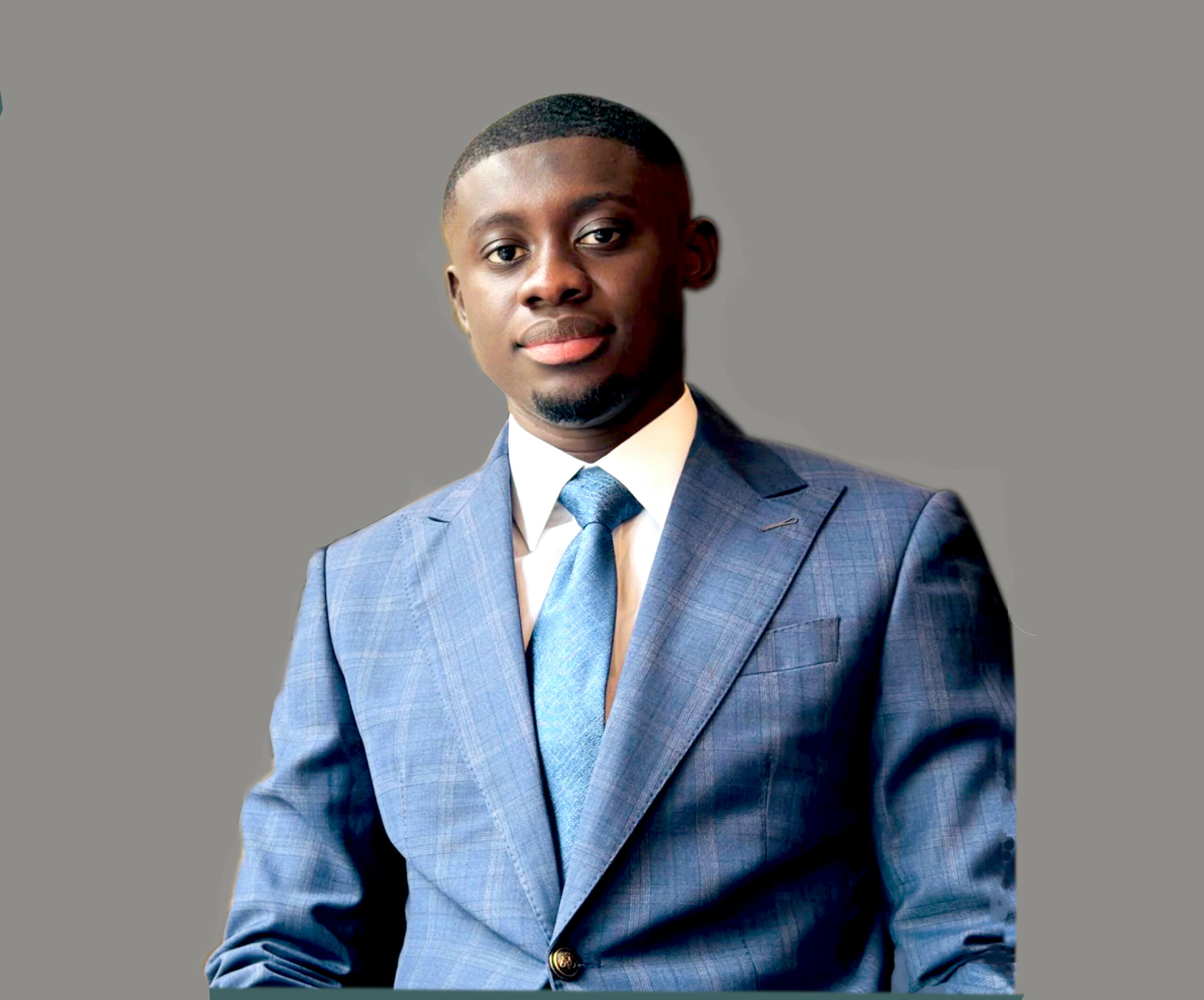








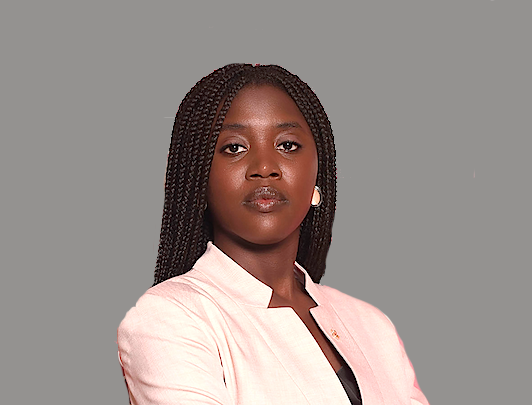


Laisser un commentaire