Né avec une passion pour les sciences et la rigueur technique, héritage familial certainement, KONÉ Abdoul Soukpafolo s’est progressivement imposé comme un ingénieur polyvalent et engagé, à la croisée du génie industriel, de la gestion de projet et du développement des énergies durables. Après avoir été pensionnaire de l’école Catholique Saint Elisabeth de Korhogo, où il sort comme Major de la Ville, il décroche son BAC scientifique (avec mention), avant de poursuivre ses études supérieures en France. D’abord à l’Université Claude Bernard-Lyon I, puis à l’École des Mines de Saint-Étienne où il décroche son diplôme d’ingénieur. Après une première immersion professionnelle en France chez LEGRAS INDUSTRIES en tant qu’apprenti Ingénieur, Abdoul Soukpafolo KONE retourne en Côte d’Ivoire pour participer au développement du Groupe crée par son père. Aujourd’hui, Administrateur de plusieurs entités du Groupe familial, il partage, dans cet entretien, sa vision pour La Compagnie Moderne de Production de Caoutchouc (CMPC), qu’il dirige, et nous livre sa réflexion sur les défis du secteur agro-industriel en Afrique. INTERVIEW
Qu’est ce qui a motivé la création de la Compagnie Moderne de Production de Caoutchouc (CMPC) et quelles sont ses principales activités ?
La Compagnie Moderne de Production de Caoutchouc (CMPC) a été créée pour répondre à plusieurs enjeux économiques, industriels et sociaux liés au secteur du caoutchouc naturel en Côte d’Ivoire et dans la sous-région. En effet, elle est née dans une dynamique de valorisation locale des matières premières, en transformant localement le caoutchouc naturel (Fonds de tasses d’hévéa) produits par les planteurs ivoiriens afin de réduire la dépendance du pays aux exportations de matières non transformées et d’accroître la valeur ajoutée nationale. Face à la forte demande mondiale en caoutchouc naturel, notamment dans les secteurs de l’automobile, elle a des pneumatiques et de l’industrie manufacturière, nous avons trouvé en CMPC une opportunité de diversification de nos activités opérationnelles, pour la plupart concentrées au Nord de la Côte d’Ivoire. A cet effet, la CMPC s’est positionnée comme un acteur capable d’assurer une production régulière, compétitive et conforme aux standards internationaux de qualité en seulement 4 mois de Production. Nos produits sont exportés à travers le monde. La CMPC contribue également à la structuration de la filière en soutenant les producteurs locaux, en favorisant leur professionnalisation et en modernisant les circuits d’approvisionnement pour leur garantir des débouchés stables et équitables, en toute transparence et de façon directe.
Enfin, la CMPC adopte une démarche résolument environnementale et durable à travers l’ensemble de ses activités, allant de la collecte et de l’achat du caoutchouc naturel auprès des planteurs partenaires à la transformation industrielle en produits normalisés conformes aux standards internationaux (CMPC 10, etc.). Elle assure également la commercialisation et l’exportation de ses produits vers les marchés mondiaux, tout en apportant un appui technique et des formations aux producteurs afin d’améliorer leur productivité et la qualité du caoutchouc. Ses produits sont notamment exportés à travers le monde, vers la Chine, les États-Unis, l’Inde, le Vietnam, la Turquie et ne citer que ceux-ci.
La CMPC appartient a un Groupe Industriel diversifié, la concentration autour de quelques pôles de croissance constitue-t-elle selon vous, un choix judicieux ?
Absolument. La concentration autour de pôles de croissance clairement identifiés est un choix à la fois stratégique et responsable. Dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, il est essentiel pour un groupe industriel de renforcer sa cohérence et sa lisibilité. En se focalisant sur des domaines d’activités prioritaires, le Groupe optimise l’utilisation de ses ressources et consolide ses compétences sur des segments à fort potentiel. Cette approche permet avant tout de mieux maîtriser nos métiers, d’accroître les synergies entre les différentes filiales et d’assurer une meilleure allocation des ressources humaines, techniques et financières. Elle nous offre également une plus grande résilience face aux fluctuations du marché, car nos efforts sont concentrés sur des pôles dont la croissance est soutenue et durable.
Certains pensent que l’investissement dans l’agriculture et dans l’agro-industrie en Afrique est encore risqué. Etes-vous de cet avis ?
Pas du tout. Bien au contraire, nous considérons que l’agriculture et l’agro-industrie représentent une opportunité stratégique pour les investisseurs visionnaires, encore plus, le véritable poumon de l’économie africaine. En effet, le continent dispose d’atouts considérables que peu de régions au monde peuvent revendiquer : des terres arables vastes et fertiles, une biodiversité exceptionnelle, des ressources naturelles abondantes et surtout une main-d’œuvre jeune et dynamique. L’Afrique possède près de 60 % des terres arables non exploitées de la planète. Ce potentiel, s’il est bien structuré et valorisé, peut non seulement nourrir le continent, mais aussi en faire un acteur majeur de la sécurité alimentaire mondiale.
L’un des griefs sur le retard industriel de l’Afrique concerne le rôle des banques dans ce secteur. Il leur est notamment reproché de privilégier le financement du commerce au détriment du secteur industriel. Partagez-vous cette thèse ?
Je dirais que ma position est mitigée. Il est vrai que, dans de nombreux cas, les banques et institutions financières ont tendance à favoriser le financement du commerce, notamment parce que ces opérations sont plus rapides, mieux maîtrisées et présentent des risques plus faibles à court terme. Le commerce offre une rotation de capitaux plus rapide, une visibilité claire sur les flux financiers, et des garanties souvent plus tangibles, ce qui correspond à la logique prudentielle du système bancaire. En revanche, les projets industriels et agro-industriels, comme ceux que nous menons à la CMPC, requièrent des investissements lourds, des périodes de maturation plus longues et des risques techniques et opérationnels plus complexes à couvrir, et même des fluctuations de prix non maitrisables en amont. De ce fait, Les banques doivent souvent mettre en place des mécanismes de couverture de risques spécifiques, ce qui rend l’accès au financement plus difficile et plus coûteux pour ce type de projets.
En définitive, Je ne dirais pas qu’elles ne soutiennent pas, mais plutôt que le cadre de financement n’est pas encore totalement adapté aux réalités du secteur industriel. Cela dit, les choses évoluent. De plus en plus d’institutions comprennent aujourd’hui que le développement durable passe par la transformation locale, et non uniquement par le commerce des matières premières. Nous devons donc encourager une collaboration plus étroite entre les acteurs industriels, les institutions financières et l’État, afin de réduire les risques perçus et de créer des mécanismes de financement innovants. C’est à ce prix que nous pourrons bâtir un tissu industriel solide, générateur d’emplois et de valeur ajoutée sur le continent.
L’ouverture au commerce mondial, sans protections douanières, n’a-t-elle pas freiné l’émergence industrielle de certains pays ? Ne faut-il pas des clauses de « préférence nationale » ?
Je comprends parfaitement cette préoccupation, mais je pense qu’il faut l’aborder dans une logique de développement progressif. L’ouverture au commerce mondial a certes exposé nos économies à une concurrence parfois déséquilibrée, mais elle a également permis de stimuler la modernisation et d’encourager l’innovation locale. Aujourd’hui, notre priorité doit être de renforcer la compétitivité de nos industries locales. À mesure que nous parviendrons à produire localement des biens de qualité, à des coûts de revient compétitifs, capables de rivaliser avec les produits importés, il sera alors tout à fait légitime que l’État prenne ses responsabilités en instaurant des mécanismes de protection ciblés, au bénéfice des producteurs nationaux. D’ailleurs, plusieurs initiatives structurantes sont déjà en cours : la mise en place de zones industrielles modernes, le développement d’infrastructures énergétiques de pointe, le renforcement du système éducatif et d’apprentissage, un réseau routier d’envergure et la création d’un environnement propice à la transformation locale. Ces efforts visent à établir un cadre solide permettant à nos industries d’émerger durablement. Une fois ce cadre consolidé, l’État pourra progressivement appliquer des taxes conjoncturelles ou des mesures de régulation pour protéger la production nationale — comme c’est déjà le cas dans certains secteurs, notamment celui des sacs de jute, où des mesures spécifiques ont été adoptées pour soutenir la production locale. En somme, la préférence nationale ne doit pas être une fermeture, mais une conséquence naturelle d’une montée en puissance industrielle réussie. Le véritable enjeu est d’abord de bâtir la compétitivité, et le reste suivra de manière structurée et équilibrée.
Que pensez-vous de l’idée d’un véritable « Plan Marshall » industriel pour certains pays africains, afin de les aider à produire plus et mieux ?
L’idée d’un « Plan Marshall » industriel pour certains pays africains est très intéressante et pertinente, mais elle doit être adaptée à nos réalités locales. Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas seulement un soutien financier massif, mais un ensemble cohérent d’initiatives qui favorise le développement durable et la montée en compétence des industries locales.
Concrètement, cela pourrait passer par :
- Des investissements ciblés dans les infrastructures industrielles, logistiques et énergétiques ;
- Des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux pour le transfert de technologie et le renforcement des compétences locales ;
- Un accompagnement des filières prioritaires, comme l’agro-industrie, le textile, la métallurgie ou la chimie, afin de transformer les matières premières sur place et créer de la valeur ajoutée.
L’expérience montre qu’un tel plan doit être progressif et intégré : il doit combiner financement, formation, innovation et réglementation pour créer un environnement propice à l’industrialisation. C’est ce que certains pays africains commencent à faire avec succès, dont la Côte d’Ivoire avec ses initiatives dans l’énergie, l’agriculture, l’éducation, le commerce & l’industrie, la santé,…. En résumé, un « Plan Marshall » africain est une vision stratégique séduisante, mais sa réussite dépendra de la capacité des États à créer un cadre favorable, de l’engagement des acteurs privés et du suivi rigoureux des projets pour garantir que les investissements génèrent réellement production, emplois et compétitivité. Cela, dans la perspective de créer, aujourd’hui, l’Afrique innovante de demain par des jeunes leaders formés et sans complexe.
Propos recueillis par A.C. DIALLO – ©Magazine BUSINESS AFRICA


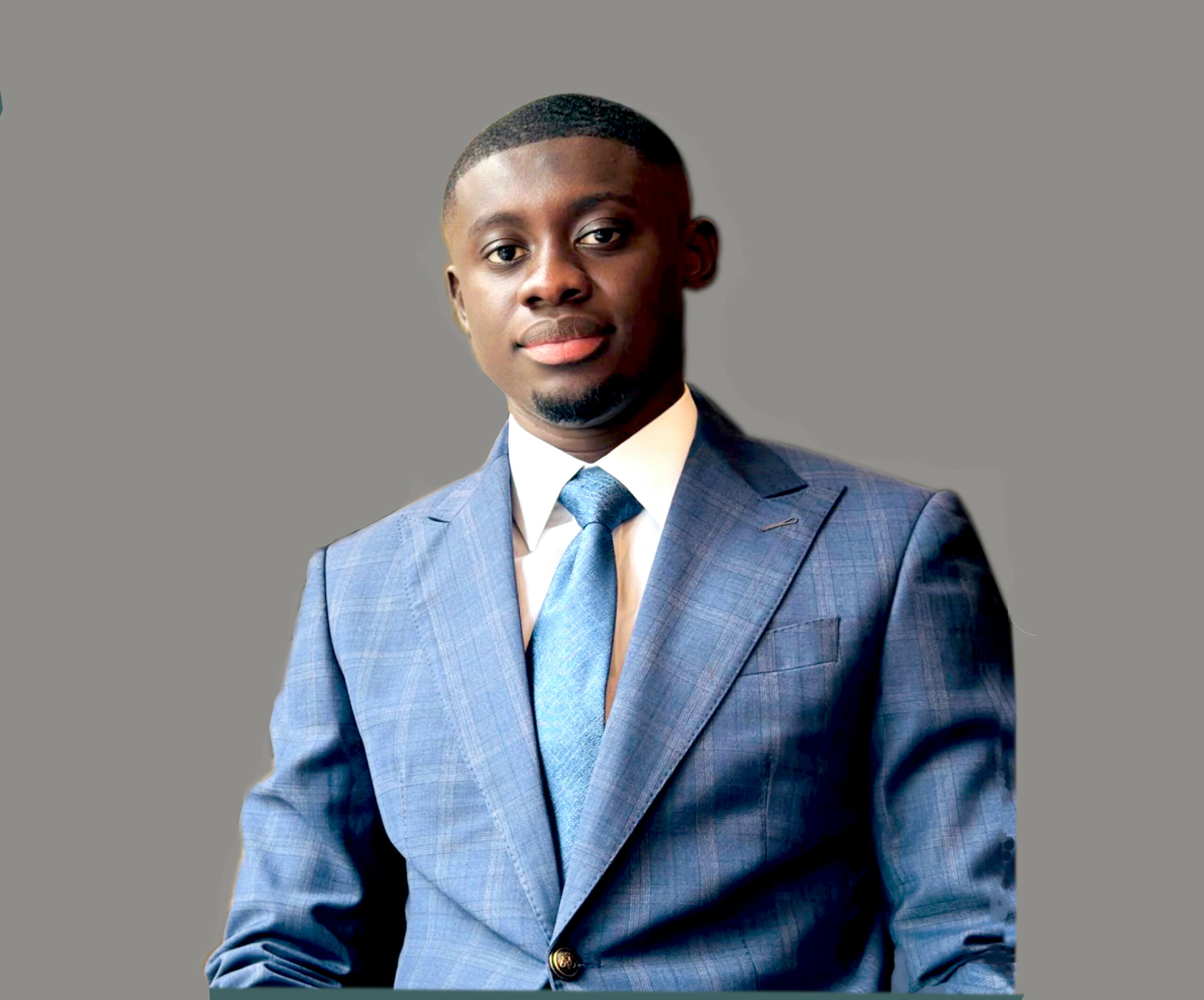
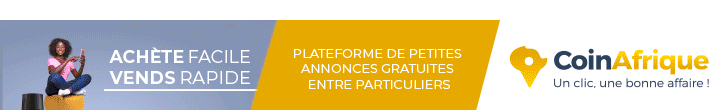









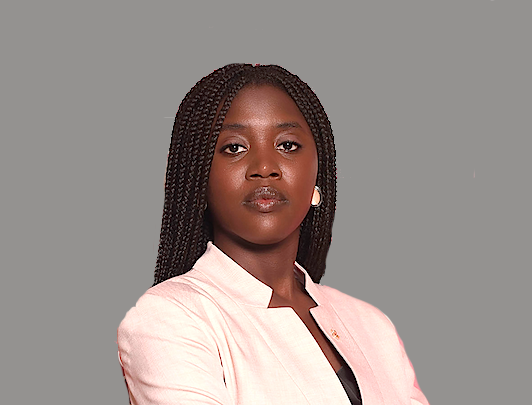



Laisser un commentaire