Souleymane SOUMAORO est docteur en droit, diplômé de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il exerce aujourd’hui en tant qu’avocat associé au sein du cabinet WAC Partners à Bamako, fondé par Me Abdoulaye OUANE. WAC Partners est un cabinet panafricain qui intervient principalement dans l’espace juridique de la CEDEAO et de la zone OHADA. Ses activités couvrent plusieurs secteurs stratégiques tels que l’énergie, le pétrole et le gaz, la construction, les infrastructures, les mines, le transport, l’hôtellerie, les activités portuaires et les partenariats-public-privé (PPP). Souleymane SOUMAORO pratique le droit des affaires avec un accent particulier sur : la gouvernance d’entreprise, les projets structurants, le conseil aux dirigeants et administrateurs, ainsi que les opérations exceptionnelles (fusions, acquisitions, augmentations de capital, etc.). Il est également Consultant externe pour le réseau JUNCTION LAW, qui regroupe des avocats et experts indépendants en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (zone EMEA), et qui intervient dans les domaines du regulatory, des PPP, des projets, de l’arbitrage et de la médiation. Enfin, il enseigne à l’Institut Africain de Technologies et de Management (ITMA), convaincu que l’enseignement constitue le prolongement naturel de la pratique du droit, en permettant la transmission du savoir et du savoir-faire.
Le Magazine BUSINESSS AFRICA a recueilli son analyse sur le climat des affaires et les conditions d’une meilleure attractivité des pays africains. INTERVIEW
De nombreux pays africain ont adopté des mesures législatives et réglementaires pour attirer plus d’investissements nationaux et internationaux. Quel bilan en faites-vous ? Cela suffit-il ?
Le rôle des gouvernements africains est déterminant dans la création d’un environnement attractif pour les investisseurs. Cela commence par la mise en place d’un cadre juridique et réglementaire solide, clair et protecteur. Ces réformes ont déjà porté leurs fruits : plusieurs pays africains ont enregistré ces dernières années des taux de croissance parmi les plus élevés depuis leur indépendance. Ces avancées ne sont pas seulement théoriques. Elles se traduisent concrètement dans certains secteurs stratégiques, en particulier la transition énergétique. Les dix dernières années ont vu une multiplication des projets africains dans les énergies renouvelables, grâce à des réformes favorables qui ont attiré à la fois des capitaux nationaux et internationaux en Afrique. Cet exemple illustre bien l’impact positif d’un cadre juridique adapté sur l’investissement privé. Cependant, la sécurité juridique, bien qu’essentielle, ne suffit pas. L’attractivité repose également sur la sécurité, la stabilité politique et la bonne gouvernance. À ce titre, la mise en œuvre de la ZLECAF (Zone de libre-échange continentale africaine) constitue une avancée majeure : elle ouvre un marché unique de plus de 1,4 milliard d’habitants, réduit les barrières commerciales, favorise l’harmonisation des règles et envoie un signal politique fort de stabilité et d’intégration régionale. Autant d’éléments qui renforcent la confiance des investisseurs. En définitive, les mesures législatives et réglementaires sont une condition nécessaire mais non suffisante. Pour attirer durablement les investissements, elles doivent s’accompagner d’efforts en matière de gouvernance, de sécurité, de transparence et d’efficacité administrative. L’investisseur recherche avant tout de la visibilité et de la prévisibilité, sans lesquelles même le meilleur cadre juridique reste lettre morte.
Certains analystes déplorent en Afrique, l’existence d’investissements fantômes dans des entités sans activité économique réelle, servant simplement de holdings qui réalisent des financements intragroupes ou gèrent des actifs incorporels dans un but d’éviter l’impôt ? Est-ce une réalité ?
Il est vrai que certaines études, notamment du FMI, ont estimé qu’environ 40 % des investissements directs étrangers transitent par des « sociétés écrans » ou entités sans activité réelle, utilisées à des fins fiscales ou de financement intragroupe. Mais il faut rappeler que ce phénomène n’est pas propre à l’Afrique , et je pense qu’on le retrouve dans certaines juridictions « Tax Friendly » ou « Tax Free » comme le Luxembourg ou les Emirats Arabes Unis. Pour ma part, dans les projets structurants que j’ai accompagnés en Afrique, je n’ai jamais été confronté à ce type d’investissement. Les investisseurs que j’ai conseillés s’impliquaient pleinement dans les projets, à la fois sur le plan capitalistique (prise de participation dans les sociétés de projet) et sur le plan financier (apports en fonds nécessaires à la réalisation). En Afrique, les grands projets ont généralement une dimension réelle et tangible, car ils répondent à des besoins économiques et sociaux majeurs.
Quels sont les principaux freins à l’attractivité économique d’un pays ?
L’attractivité d’un pays repose sur sa capacité à réduire les risques perçus par les investisseurs. Or, plusieurs freins persistent :
- Freins judiciaires : lenteur des procédures, manque de spécialisation de certains juges en matière économique et commerciale, parfois déficit d’indépendance de la justice.
- Freins administratifs : lourdeur et complexité des procédures, multiplicité des interlocuteurs, manque de guichet unique.
- Freins sécuritaires : instabilité politique, conflits armés, menaces terroristes, qui fragilisent la confiance des investisseurs.
- Freins liés à la gouvernance : corruption, absence de transparence, instabilité réglementaire et fiscale.
Réduire ces obstacles, juridiques, politiques et sécuritaires, est essentiel pour faire de l’Afrique une destination compétitive à l’échelle mondiale. D’ailleurs, ces freins ne sont pas insurmontables : certains pays africains ont déjà engagé des réformes encourageantes, par exemple la digitalisation de procédures administratives (Sénégal, baptisée « New Deal Technologique ») ou l’adoption de mesures et d’institutions pour concrétiser les principes de bonne gouvernance (Côte d’Ivoire). Ces initiatives montrent que l’Afrique avance dans la bonne direction.
Hier la crise sanitaire et aujourd’hui les tensions géopolitiques ont incité et conduit les Etats à reconsidérer l’équilibre entre attraction des investissements étrangers et souveraineté économique. Ne pensez-vous pas que les pays africains devraient mieux surveiller les IDE afin d’éviter que certains secteurs stratégiques (Energie, Agriculture…) ne soient détenus par des acteurs étrangers ? Quel peut être l’apport du droit dans ce domaine ?
Je souhaite apporter une précision : le volume des flux d’IDE (Investissements Directs Étrangers) destinés à l’Afrique demeure très faible comparé aux autres régions en développement. Le continent ne capte qu’environ 3 à 6 % des flux mondiaux. Dans plusieurs pays d’Afrique du Nord et en partie en Afrique subsaharienne, les envois de fonds de la diaspora dépassent désormais les IDE comme principale source de devises extérieures. Néanmoins, il apparaît essentiel que les États africains encadrent mieux les investissements étrangers, en particulier dans les secteurs stratégiques comme l’énergie, l’agriculture ou les infrastructures, afin de préserver leur souveraineté économique et d’éviter une dépendance excessive vis-à-vis d’acteurs étrangers. Dans ce sens, les réformes récentes des codes miniers (au Mali et en Guinée) et l’adoption de lois relatives au contenu local (au Sénégal, au Mali et en Côte d’Ivoire) confirment la volonté des États africains de renforcer leur contrôle et de favoriser la participation nationale dans ces secteurs stratégiques. Le droit joue donc un rôle central en posant des garde-fous juridiques, en définissant des obligations de contenu local, en encadrant les partenariats public-privé et en créant un cadre de gouvernance équilibré qui assure à la fois l’attractivité des IDE et la préservation des intérêts stratégiques nationaux.
Quels sont, selon vous, les fondamentaux juridiques pour une meilleure sécurisation d’un investissement, qu’il soit national ou international ?
La sécurisation des investissements repose sur quelques principes essentiels :
- un cadre juridique moderne, qui s’adapte aux évolutions économiques et technologiques,
- une lisibilité et une stabilité des règles, afin d’assurer la prévisibilité des investissements,
- une justice spécialisée, efficace et indépendante, capable de trancher des litiges complexes,
- l’existence de mécanismes alternatifs (arbitrage, médiation) pour offrir des voies de règlement flexibles.
À cet égard, l’OHADA est un exemple concret d’intégration régionale réussie : son droit uniforme renforce la confiance des investisseurs et réduit les incertitudes liées aux différences de législation.
Quel est votre sentiment sur le rôle des Agences de Promotion des Investissements, créées dans de nombreux pays africains. Leur mission se justifie-t-elle dès lors que le cadre juridique et l’environnement des affaires sont suffisamment incitatifs ?
Ces agences portent des noms différents selon les pays : APIX au Sénégal, API au Mali, ABI au Burkina Faso, etc. Leur rôle reste essentiel. Même lorsque le cadre juridique est attractif, elles apportent une valeur ajoutée en agissant comme guichet unique. Elles facilitent la création d’entreprises, délivrent les agréments prévus par les codes d’investissement, et accompagnent les investisseurs dans leurs démarches. Pour un investisseur étranger qui ne connaît pas les règles et procédures locales, ces agences représentent un point d’entrée stratégique. Elles jouent aussi un rôle de promotion active, en mettant en avant les opportunités offertes par leur pays, et en proposant parfois des régimes fiscaux avantageux différents de ceux prévus par d’autres textes spécifiques (code minier, code pétrolier, etc.).
Quelles sont, d’après vous, les perspectives de développement des investissements en Afrique, au regard du contexte géopolitique international ?
Selon la Banque mondiale, l’Afrique connaît depuis une dizaine d’années une croissance économique remarquable, malgré les crises mondiales. Le continent reste résilient, mais ses besoins de financement sont colossaux : environ 90 milliards de dollars par an sur les 15 prochaines années. Sa population devrait doubler d’ici 2050, ce qui représente un potentiel de marché unique. Les investisseurs internationaux s’intéressent déjà aux secteurs extractif, énergétique, immobilier, agricole et, plus récemment, à la gestion de l’eau. L’agriculture, en particulier, pourrait transformer l’Afrique en véritable grenier du monde si les investissements nécessaires sont réalisés. Les perspectives sont donc très positives. Mais pour maintenir cette dynamique, il faudra continuer à lever les freins à l’attractivité (judiciaires, administratifs, sécuritaires, politiques), et anticiper les grands défis à venir, en particulier le défi climatique, qui pourrait fortement impacter les économies africaines. L’Afrique a donc un potentiel unique, à condition de transformer ses défis en opportunités et de continuer à bâtir un environnement de confiance pour les investisseurs.
Propos recueillis par A.C. DIALLO – ©Magazine BUSINESS AFRICA



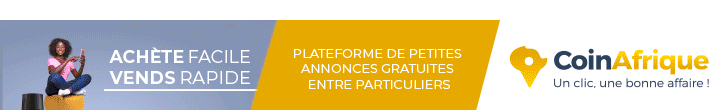

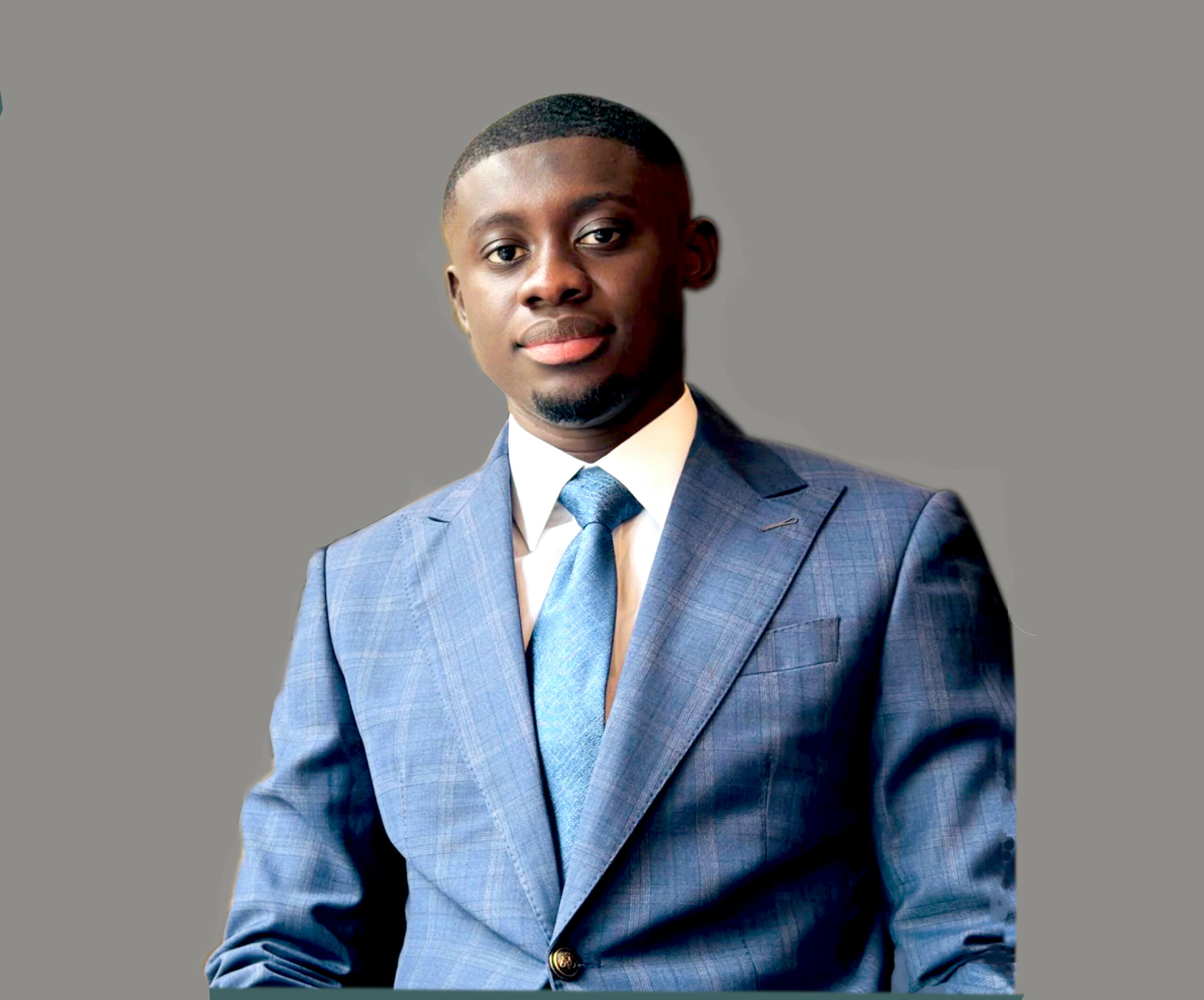









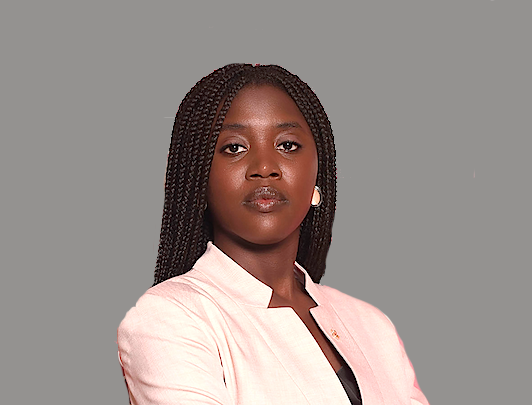


Laisser un commentaire