Les Partenariats public-privé PPP ont le vent en poupe et suscitent beaucoup d’intérêt en Afrique. Pour cause, ce type de financement permet à la puissance publique de lancer des projets conséquents sans avoir nécessairement d’importantes capacités d’emprunt, grâce au recours au financement privé. Les PPP sont perçus comme une réelle opportunité, un levier pour mettre en place des infrastructures faisant défaut aux populations (énergie, transport, assainissement…). Mais ce type de financement, de par sa spécificité, n’est pas juridiquement sans risque. Pour en savoir plus, le Magazine BUSINESS AFRICA a interviewé Assemian Faustin Kouakou, Managing Partner de Ofori Conseils Africa, un cabinet de Conseils Juridique basé à Abidjan en Côte d’Ivoire et opérant dans toute l’Afrique francophone, dans des secteurs aussi variés que les Assurances & Réassurances, Banque et Marchés des Capitaux, l’Énergie, les Infrastructures, les Mines, les Fintech et la Fiscalité. ENTRETIEN
En quoi, sur le plan juridique, le financement de projets d’infrastructures est-il spécifique ?
Sur le plan juridique, le financement des projets d’infrastructures en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest se distingue d’abord par le recours fréquent aux Partenariats Public-Privé (PPP). Ce mécanisme permet à l’État de s’appuyer sur le secteur privé pour concevoir, financer, construire et exploiter des ouvrages d’intérêt public, tout en préservant la soutenabilité budgétaire. En Côte d’Ivoire, les PPP sont encadrés par un cadre légal spécifique ( Décret n°2018‐358 du 29 mars 2018 déterminant les règles relatives aux contrats de partenariats public‐privé), qui impose des exigences en matière de transparence, de passation des marchés et de répartition des risques entre les parties.
La seconde spécificité juridique réside dans la complexité des montages financiers, souvent qualifiés de financement structuré. Les projets d’infrastructures mobilisent des montants importants et font intervenir plusieurs bailleurs (banques commerciales, institutions de développement, fonds souverains, garants), ce qui nécessite la mise en place d’une documentation contractuelle dense : contrat de partenariat, convention de crédit, sûretés, accords inter-créanciers, clauses de substitution, etc. Ces montages visent à sécuriser les flux financiers et à garantir la bancabilité du projet.
Enfin, ces projets sont à la croisée du droit public, du droit privé et parfois du droit international. Ils posent des enjeux juridiques variés : régulation sectorielle, fiscalité, foncier, environnement, et résolution des différends. L’équilibre entre les prérogatives de puissance publique de l’État et les attentes des investisseurs privés est central. La réussite juridique d’un projet d’infrastructure repose donc sur une bonne répartition des risques, une conformité réglementaire stricte et une architecture contractuelle solide.
Quels sont, en Afrique, les principaux enjeux juridiques liés au financement de projets d’infrastructures ?
En Afrique, les enjeux juridiques du financement des projets d’infrastructures sont particulièrement importants du côté public, car l’État est généralement à l’initiative des projets, notamment dans le cadre des Partenariats Public-Privé (PPP). Il lui revient de définir les besoins, de lancer la procédure de passation, et d’encadrer juridiquement la relation contractuelle. Cela implique de respecter les textes en vigueur, d’assurer la transparence de la procédure, et de garantir la soutenabilité budgétaire de l’engagement public.
L’un des principaux défis juridiques pour l’État est d’assurer une bonne répartition des risques dans le contrat, de sécuriser le foncier et de définir clairement les mécanismes de rémunération du partenaire privé. Un montage juridique approximatif ou une irrégularité dans la passation du contrat peut compromettre l’attractivité du projet et empêcher son financement par les bailleurs.
Du côté des investisseurs privés, les enjeux portent sur la sécurité juridique des engagements publics, la stabilité du cadre réglementaire, la protection contre les risques politiques, et l’accès à des mécanismes fiables de règlement des différends. Pour garantir la bancabilité du projet, il est essentiel que les contrats intègrent des clauses solides (garanties de paiement, clauses de stabilisation, droits de substitution) et que l’environnement juridique permette une exécution sereine sur toute la durée du partenariat.
Existe-t-il une régulation juridique des PPP dans le cadre de l’OHADA ? Si non, comment les investisseurs peuvent-ils sécuriser juridiquement un PPP contre les risques politiques ou sécuritaires ?
Il n’existe pas encore à ce jour d’acte uniforme spécifique qui régule les PPP dans l’espace OHADA. Les PPP sont pour l’instant encadrés par le doit interne des Etats membres de l’OHADA, notamment par les lois nationales (sectorielles) ainsi que les décrets d’application. Il est donc essentiel pour les investisseurs intéressés par des PPP dans un pays membre de l’OHADA de se familiariser avec les lois nationales et les mécanismes de régulation des PPP dans ce pays.
En ce qui concerne la zone UEMOA[1], il convient de préciser que le 30 septembre 2022, l’UEMOA a adopté une nouvelle Directive visant à harmoniser le cadre juridique et institutionnel des Partenariats Public-Privé (PPP) dans les États membres. Ce texte renforce la transparence et la cohérence des pratiques dans la mise en œuvre des projets d’infrastructures et complète la Directive de 2005 sur les marchés publics. Il impose à chaque État membre de se doter d’un dispositif institutionnel couvrant toutes les étapes du cycle de vie des PPP : de l’identification à l’exécution, en passant par la passation et le suivi. La Directive encadre deux types de procédures de passation : les procédures de droit commun (appels d’offres ouverts) et les procédures dérogatoires (dialogue compétitif, appel restreint, négociation directe), ces dernières étant soumises à autorisation préalable. Elle introduit également des mécanismes spécifiques pour les offres spontanées, les petits projets, et les PPP réservés aux entreprises communautaires.
Entrée en vigueur dès sa signature, la Directive accorde un délai de trois ans aux États membres pour transposer ses dispositions dans leur droit national. Elle marque ainsi une étape décisive vers une meilleure gouvernance des projets PPP dans l’espace UEMOA.
S’agissant de la sécurisation juridique des PPP contre les risques politiques et sécuritaires, il convient de préciser que les risques politiques ou sécuritaires varient considérablement d’un pays du continent à un autre ou du type de projets. Par conséquent, il importe que les investisseurs consultent des juristes spécialisés locaux pour obtenir des conseils adaptés au projet et à l’environnement légal et intégrer dans les contrats à conclure les mécanismes pour atténuer, limiter ou contourner les risques identifiés.
Parmi les mécanismes de nature à atténuer ou limiter les risques politiques ou sécuritaires, les investisseurs doivent s’assurer que dans leur contrat PPP figurent des clauses claires et solides prévoyant, notamment, des indemnisations par l’entité publique en cas de non-respect de ses engagements contractuels ou des mécanismes de résolution des différends dans un forum neutre et indépendant.
Ces dispositions sont-elles acceptées par la partie publique ?
Les clauses de protection contre les risques politiques ou sécuritaires sont généralement proposées par les investisseurs dans les contrats de PPP, et sont en principe acceptées par la partie publique, à condition qu’elles soient équilibrées et compatibles avec les intérêts de l’État. Tant qu’elles ne portent pas atteinte aux prérogatives souveraines ni à l’équilibre économique du contrat, les autorités contractantes, souvent accompagnées de conseillers juridiques ou d’institutions partenaires, les intègrent volontiers, notamment dans les projets impliquant des bailleurs internationaux. Leur acceptabilité repose sur une négociation anticipée et bien structurée, prenant en compte à la fois la sécurité juridique recherchée par l’investisseur et les obligations de service public de l’État.
Quelles sont, selon vous, les conditions pour que les PPP soient en Afrique, une option économiquement viable pour la fourniture d’infrastructures publiques ?
Pour que les Partenariats Public-Privé (PPP) constituent une option économiquement viable en Afrique pour le développement des infrastructures publiques, plusieurs conditions préalables doivent être réunies, tant sur le plan institutionnel que juridique, financier et humain. Tout d’abord, les États doivent pleinement considérer les PPP non comme une substitution au financement public, mais comme un outil stratégique de mobilisation du capital privé, permettant de limiter la pression sur les finances publiques tout en accélérant la réalisation des équipements collectifs. Cette logique suppose une gestion rigoureuse de la dette publique et une approche fondée sur la valeur pour le contribuable.
Ensuite, les PPP doivent offrir un environnement juridique stable et protecteur pour les investisseurs, notamment en réduisant les risques politiques et en assurant une répartition claire, équilibrée et contractuellement encadrée des risques inhérents à la conception, au financement, à la construction et à l’exploitation des infrastructures. Cela implique l’existence de lois nationales sur les PPP alignées sur les standards régionaux (ex. Directive UEMOA de 2022), de mécanismes efficaces de règlement des différends (comme l’arbitrage), et de garanties institutionnelles crédibles.
Enfin, pour attirer les capitaux privés à grande échelle, il est recommandé de développer des instruments de financement innovants tels que les fonds d’infrastructure, les obligations adossées à des projets (project bonds), et les véhicules de financement structuré. Ces mécanismes permettent de mutualiser les risques, d’allonger la maturité des financements et de diversifier les sources de capitaux.
Quelles sont les modalités de règlement des différends dans les projets d’infrastructures ? Entre le recours à l’arbitrage (institutionnel ou ad hoc) et un mode alternatif de règlement des litiges, lequel est le plus souvent privilégié ? Pourquoi ?
L’arbitrage international, qu’il soit institutionnel (CIRDI, CCI, CCJA, etc.) ou ad hoc, est le mode de règlement des litiges le plus usité dans les contrats de partenariat car ils offrent aux partenaires privés davantage de garanties de neutralité, d’indépendance et d’impartialité que les juridictions locales qui sont souvent perçues, à tort ou à raison, avec méfiance. L’arbitrage permet également une certaine célérité dans le règlement des différends, ce qui a une importance capitale pour les investisseurs.
Nous avons, par exemple, récemment agi en qualité de conseil juridique local de l’IFC, filiale du Groupe de la Banque mondiale, dans le cadre d’un projet de financement d’infrastructures de traitement des déchets solides en Côte d’Ivoire. À cette occasion, l’IFC a expressément exigé que l’arbitrage international soit retenu comme mode de règlement des différends, conformément aux standards internationaux en matière de protection des investissements.
La législation ivoirienne régissant les PPP et à leur financement, est-elle selon vous adaptée ? Donne-t-elle aux bailleurs de fonds et aux investisseurs potentiels les assurances voulues ?
La législation ivoirienne encadrant les PPP est globalement adaptée, mais elle doit faire l’objet de mises à jour régulières pour rester en adéquation avec les besoins locaux.
Par ailleurs, la fiscalité applicable aux Partenariats Public-Privé (PPP) en Côte d’Ivoire repose principalement sur les règles de droit commun (Code Général des Impôts), en l’absence de législation spécifique encadrant ce régime. Les avantages fiscaux accordés dans le cadre des PPP proviennent le plus souvent de dispositions contractuelles négociées, et non de textes législatifs ou réglementaires. Cette pratique soulève des enjeux juridiques et constitutionnels, notamment au regard du principe fondamental selon lequel seule la loi peut instituer ou modifier l’impôt. Il en résulte une certaine insécurité juridique pour les parties, ainsi qu’un risque de remise en cause de ces avantages par l’administration fiscale. Il serait souhaitable de créer un cadre fiscal (juridique) spécial pour les PPP en Côte d’Ivoire. Ce régime fiscal dérogatoire renforcera la viabilité économique des différents projets et attirera davantage d’investissements privés.
Il convient par ailleurs d’indiquer que le gouvernement ivoirien a mis en place Comité National de Pilotage des Partenariats Public-Privé (CNP-PPP)[2] en 2012. Le CNP-PPP est l’organe de décision, de validation et d’orientation du cadre institutionnel de pilotage des partenariats public-privé en Côte d’Ivoire.
Conformément au décret n° 2018-359 du 29 mars 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement du Comité National de Pilotage des Partenariats Public-Privé, le CNP-PPP a pour principales missions de favoriser le développement des PPP en Côte d’Ivoire et notamment d’apporter son appui aux autorités contractantes aux différentes étapes de réalisation des PPP et de gérer le fonds d’étude dédié aux PPP.
[1] Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo
[2] https://ppp.gouv.ci/
Propos recueillis par A.C. DIALLO – ©Magazine BUSINESS AFRICA



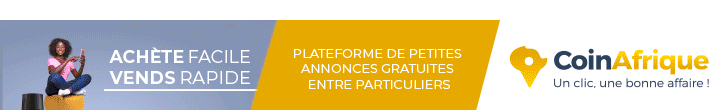

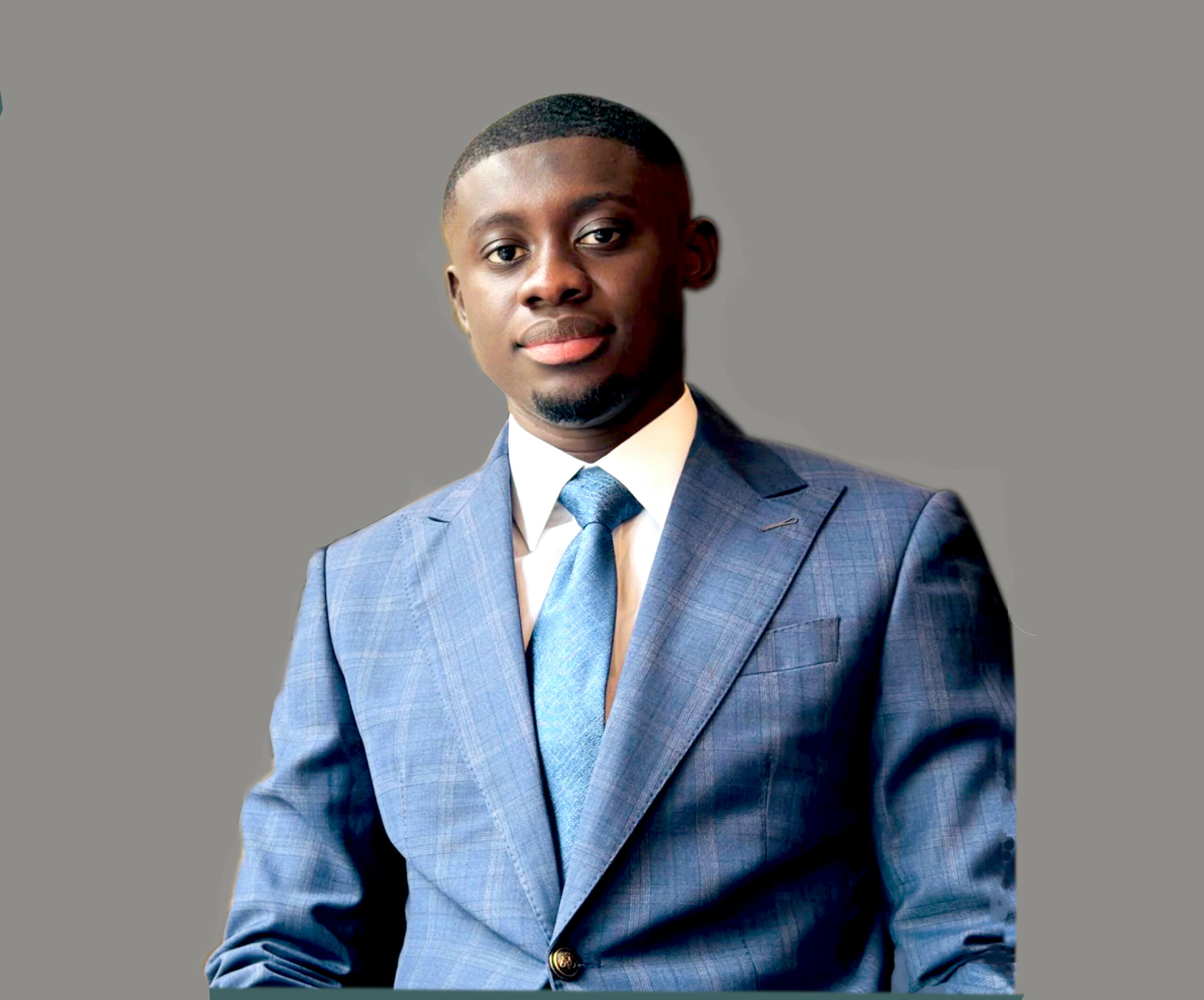









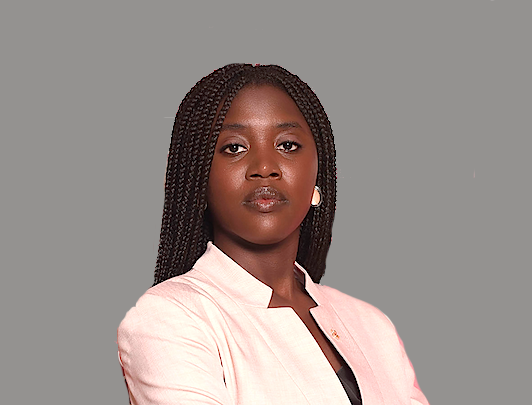


Laisser un commentaire