En Afrique, les infrastructures demeurent encore sous-financées en volume et mal financées en termes de taux d’intérêt et de délais de remboursement. Selon le dernier Rapport du Consortium pour les infrastructures en Afrique, le financement des infrastructures s’élèverait à plus de 80 milliards de dollars US. Un déficit important qu’il convient, à tout prix de combler, ceci d’autant plus que les pays africains sont souvent tenus de rembourser leurs dettes dans des délais très courts.
Me Arnaud M. TSHIBANGU, avocat aux barreaux de New York et Kinshasa et Managing Partner de Bennani & Associés RDC nous livre sa lecture de la problématique. INTERVIEW
Pensez-vous que les projets d’infrastructures répondent, en Afrique, à certains particularismes sur le plan juridique ?
S’il est communément admis que le déficit en infrastructure, en particulier énergétique et de transport, est commun à presque toute l’Afrique, il y a lieu de distinguer les besoins et les engagements selon les régions qui la composent, lesquelles recouvrent chacune des réalités différentes autant sur le plan économique que sur le plan juridique.
Cette disparité sur le plan économique est bien illustrée par le dernier rapport annuel datant de décembre 2022 sur les Tendances du financement des infrastructures réalisé par le Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA) qui indique que sur les 85 milliards de dollars engagés pour le développement des infrastructures en Afrique en 2019, 22,5 milliards de dollars d’engagements sont allés à l’Afrique de l’Ouest, suivie de l’Afrique de l’Est (16,3 milliards), de l’Afrique du Nord (15,1 milliards), de l’Afrique australe (hors Afrique du Sud) (10,8 milliards), de l’Afrique du Sud (12,7 milliards) et de l’Afrique centrale (5 milliards). Cette tendance s’est d’ailleurs confirmée en 2020.
A ces différences sur le plan économique peuvent s’ajouter des différences sur le plan juridique.
Il apparaît en effet que, selon les régions concernées, la solidité et la fiabilité des cadres législatif et règlementaire existants peuvent différer considérablement dans la mesure où ils sont considérés comme plus efficaces et robustes dans la partie Nord et Sud (en particulier l’Afrique du Sud) que dans la partie centrale du continent.
On peut par exemple se trouver en présence d’Etats qui ont certes promulgué des lois mais sans pour autant avoir pris des décrets d’application pour les mettre en oeuvre.
Ce cadre règlementaire inadapté ou déficient peut par conséquent limiter la participation du secteur privé au financement d’infrastructures nécessaires.
Quels sont, selon vous, les principaux enjeux juridiques liés au financement des projets d’infrastructures sur le continent africain ?
Après un rappel nécessaire que l’Afrique n’est pas un bloc monolithique autant sur le plan institutionnel, juridique qu’économique, on peut dégager quelques tendances observées dans la majorité des pays du continent du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest.
Il ressort de ces observations que l’un des enjeux majeurs pour le financement des projets d’infrastructure en Afrique est la faible disponibilité des capitaux à long terme et des sources de financement. Cela est notamment dû au manque de solvabilité de certains Etats africains et de confiance entre les investisseurs et les gouvernements de ces Etats.
Un autre enjeu est la mise en place d’un cadre règlementaire structuré et fiable et le renforcement des compétences dans l’administration publique.
Précisément, une solide compétence administrative est nécessaire pour établir les lois, règlements et institutions indispensables à la réalisation d’un projet. Cette étape peut présenter des difficultés particulières pour un grand nombre de pays africains en raison d’un manque de compétences ou l’insuffisance d’allocation des ressources nécessaires pour renforcer les capacités de l’administration. Il arrive souvent à cet égard qu’un pays africain ne dispose pas, dans le secteur public, du capital humain nécessaire à la réalisation d’un projet d’infrastructure requérant l’intervention de professionnels hautement qualifiés, une situation qui oblige plusieurs pays à avoir recours à une expertise extérieure.
Or, plus la structure du partenariat public – privé (PPP) est complexe, plus les besoins en conseil sont importants.
En droite ligne avec ce qui vient d’être évoqué, la phase de rédaction et de négociation des contrats de partenariat par des professionnels du droit hautement qualifiés, est un enjeu essentiel pour structurer les projets de manière optimale, identifier les risques liés à la réalisation de ces projets, prévoir des garanties et indemnités ainsi que des mécanismes adéquats et efficaces de résolution des litiges.
S’agissant des projets d’infrastructures en RDC, pays où vous êtes installés, quelles sont les problématiques juridiques les plus fréquemment soulevées ?
Il importe de souligner tout d’abord que la RDC s’est dotée, depuis le 9 juillet 2018, d’un cadre législatif avec une loi relative au partenariat public-privé (Loi sur les PPP) pour renforcer le cadre règlementaire dans le financement de projets d’infrastructures qui était jusqu’alors principalement encadré par le Code des marchés publics datant de 2010.
Toutefois, cet outil législatif, encore à un stade embryonnaire de sa mise en oeuvre, doit sans doute être complété par des mesures règlementaires destinées à renforcer le cadre existant et contribuer à résoudre les problématiques juridiques fréquemment rencontrées.
Parmi les problématiques les plus fréquentes, on peut citer une administration parfois déficiente et pas suffisamment outillée ou formée pour mettre en oeuvre les textes législatifs et règlementaires pour assurer la réalisation des projets. Ainsi, même si la fonction publique peut disposer de fonctionnaires suffisamment qualifiés, ces derniers peuvent être disséminés entre plusieurs ministères et organismes publics et dans la plupart des cas, ne travaillent pas ensemble de façon efficace. Une mauvaise coordination interministérielle peut rendre ce travail encore plus complexe, long et fastidieux, ce qui décourage les investisseurs, renforce l’incertitude et prolonge les délais de développement du projet.
Une autre problématique fréquemment soulevée est l’absence de sécurité juridique des contrats conclus pour la réalisation de projets d’infrastructures liée, notamment, à la complexité des règlementations foncières, aux procédures administratives longues et peu efficientes, au non-respect des engagements contractuels par le partenaire public, au risque politique (résiliation des accords, consécutive à un changement à la tête d’institutions ou organismes étatiques) ou sécuritaire (destruction d’infrastructures).
On peut enfin relever la problématique de l’exécution en RDC des jugements étrangers ou sentences arbitrales prononcés en faveur de l’investisseur privé suite à un litige découlant de l’exécution du contrat de partenariat.
En Afrique, la tendance des projets d’infrastructures est à quel type de montage juridique : PPP, concession, marché public, régie directe… ?
Même s’ils ne constituent pas à eux seuls une panacée susceptible de résoudre tous les problèmes, on observe une tendance favorable aux PPP car ils permettent un meilleur partage des risques entre l’investisseur privé et l’entité publique et un meilleur équilibre dans les apports de chacun, le secteur privé apportant le financement et l’expertise, tandis que le gouvernement fournit le terrain et le cadre règlementaire.
S’il est vrai qu’il n’ y a pas en Afrique une définition commune de ce que constitue un PPP, certaines caractéristiques communes peuvent néanmoins être dégagées, notamment, la durée, les modalités de rémunération, le contrôle, etc.
S’agissant de la durée des PPP, elle est certes limitée mais elle peut être déterminée en fonction de la nature, de l’objet du contrat et du taux de rentabilité du projet afin de permettre au partenaire privé de recouvrer tous les coûts d’investissement, d’exploitation, d’entretien et réaliser un bénéfice.
Dans le cadre des PPP, il peut être également prévu que le partenaire privé puisse avoir une rémunération basée sur le résultat de l’exploitation de l’activité et/ou sur les recettes annexes.
Cela incite en conséquence le partenaire privé é déployer tous les efforts nécessaires pour rendre l’activité profitable.
Entre autres avantages qu’offre un tel partenariat à l’Etat, il y a celui de conserver un certain contrôle administratif et financier sur l’exploitation de l’activité bien que la maîtrise d’ouvrage revient au partenaire privé. Il y a également l’avantage de bénéficier du financement d’un projet d’intérêt général sans puiser dans le trésor public et d’obtenir à l’échéance du contrat le transfert des infrastructures réalisées et équipements acquis grâce à ce financement.
Existe-t-il une régulation juridique des PPP dans le cadre de l’OHADA ? Si non, comment les investisseurs peuvent-ils sécuriser juridiquement un PPP contre les risques politiques ou sécuritaires ?
Il n’existe pas encore à ce jour d’acte uniforme spécifique qui régule les PPP dans l’espace OHADA. Les PPP sont pour l’instant encadrés par le droit interne des Etats membres de l’OHADA, notamment par les lois nationales (sectorielles) ainsi que les décrets d’application.
Il est donc essentiel pour les investisseurs intéressés par des PPP dans un pays membre de l’OHADA de se familiariser avec les lois nationales et les mécanismes de régulation des PPP dans ce pays.
Nous précisons cependant que plusieurs organisations régionales ont mis ou envisage de mettre en place un cadre juridique et institutionnel communautaire des PPP. C’est le cas par exemple de la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) (regroupant huit pays d’Afrique de l’ouest) où cela a été mis en place par une directive datant de septembre 2022 ou de la zone de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) (regroupant six pays d’Afrique centrale) qui envisage de le faire.
En ce qui concerne la sécurisation juridique des PPP contre les risques politiques et sécuritaires, il convient de souligner que ces risques varient considérablement d’un pays du continent à un autre ou du type de projets.
Par conséquent, il importe que les investisseurs consultent des juristes locaux spécialisés pour obtenir des conseils adaptés au projet et à l’environnement légal et intégrer dans les contrats à conclure des mécanismes adéquats pour atténuer, limiter ou contourner les risques identifiés.
Parmi les mécanismes de nature é atténuer ou limiter les risques politiques ou sécuritaires, les investisseurs doivent s’assurer que dans leur contrat PPP figurent des clauses spécifiques claires prévoyant, notamment, des indemnisations par l’entité publique en cas de non-respect de ses engagements contractuels ou des mécanismes de résolution des différends au sein d’un forum de règlement neutre et indépendant.
Par ailleurs, les investisseurs seraient avisés de travailler en partenariat avec des entreprises ou des acteurs locaux privés pour bénéficier de leur connaissance du terrain en vue d’atténuer certains des risques politiques et sécuritaires.
A toutes les stratégies d’atténuations déjà évoquées s’ajoutent la possibilité pour les investisseurs de souscrire des polices d’assurances (locales ou internationales e.g. MIGA) destinées à couvrir ou partager les risques non commerciaux, notamment politiques ou sécuritaires tels que les changements de régime, l’expropriation et les conflits.
Quelles sont, selon vous, les conditions pour que les PPP soient en Afrique, une option économiquement viable pour la fourniture d’infrastructures publiques ?
Les Etats doivent pouvoir considérer les PPP comme un moyen efficace de diminuer les effets indésirables du recours au trésor public pour financer les infrastructures publiques grâce au financement de ces projets par un investisseur privé.
En outre, les PPP doivent véritablement garantir une sécurité juridique pour les investisseurs, laquelle doit découler d’un cadre juridique solide, d’une réglementation claire et efficace, de mécanismes de partage des risques équilibrés, d’une transparence et une responsabilisation accrues des entités publiques de nature à diminuer les risques, y compris politiques.
Par ailleurs, il importe de pallier le déficit de compétences administratives et techniques à même de gérer les programmes et projets de PPP par le renforcement des capacités de l’administration en ressources humaines qualifiées et en outils adaptés.
De même, il y a lieu de résoudre les dysfonctionnements institutionnels résultant de l’absence de bonne gouvernance, de transparence et de respect des normes.
Il convient enfin que les gouvernements et les investisseurs du secteur privé se tournent vers des structures de financement innovantes, telles que l’émission d’obligations, les fonds d’infrastructure et les véhicules de financement de projets. Ces structures permettent aux investisseurs de répartir leurs risques sur plusieurs projets, réduisant ainsi leur exposition à un seul projet.
Quelles sont les modalités de règlement des différends dans les projets d’infrastructures ? Entre le recours à l’arbitrage (institutionnel ou ad hoc) et un mode alternatif de règlement des litiges, lequel est le plus souvent privilégié ? Pourquoi ?
L’arbitrage international, qu’il soit institutionnel (CIRDI, CCI, CCJA, etc.) ou ad hoc, est le mode de règlement des litiges le plus usité dans les contrats de partenariat car il offre aux partenaires privés davantage de garanties de neutralité, d’indépendance et d’impartialité que les juridictions locales qui sont souvent perçues, à tort ou à raison, avec méfiance. L’arbitrage offre également une certaine confidentialité, célérité et souplesse procédurale dans le règlement des différends et reconnaissance internationale des sentences arbitrales, ce qui est d’une importance capitale pour les investisseurs.
Cependant, des modes alternatifs de règlement des litiges, tels que la médiation ou la conciliation, peuvent également être explorés en fonction des besoins et de la volonté des parties.
Propos recueillis par A.C. DIALLO – ® Magazine BUSINESS AFRICA

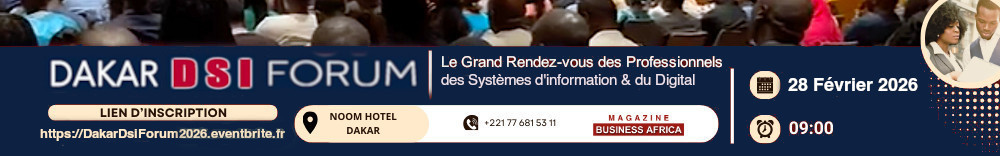

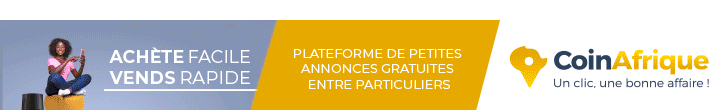
















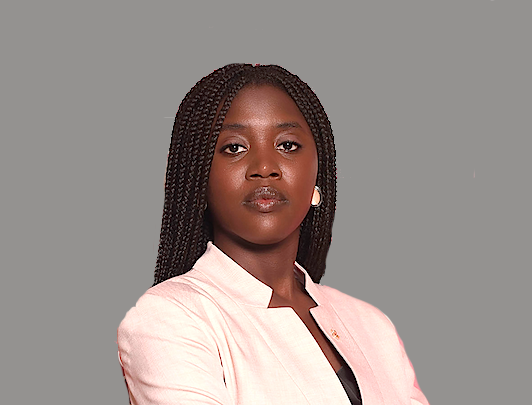


Laisser un commentaire